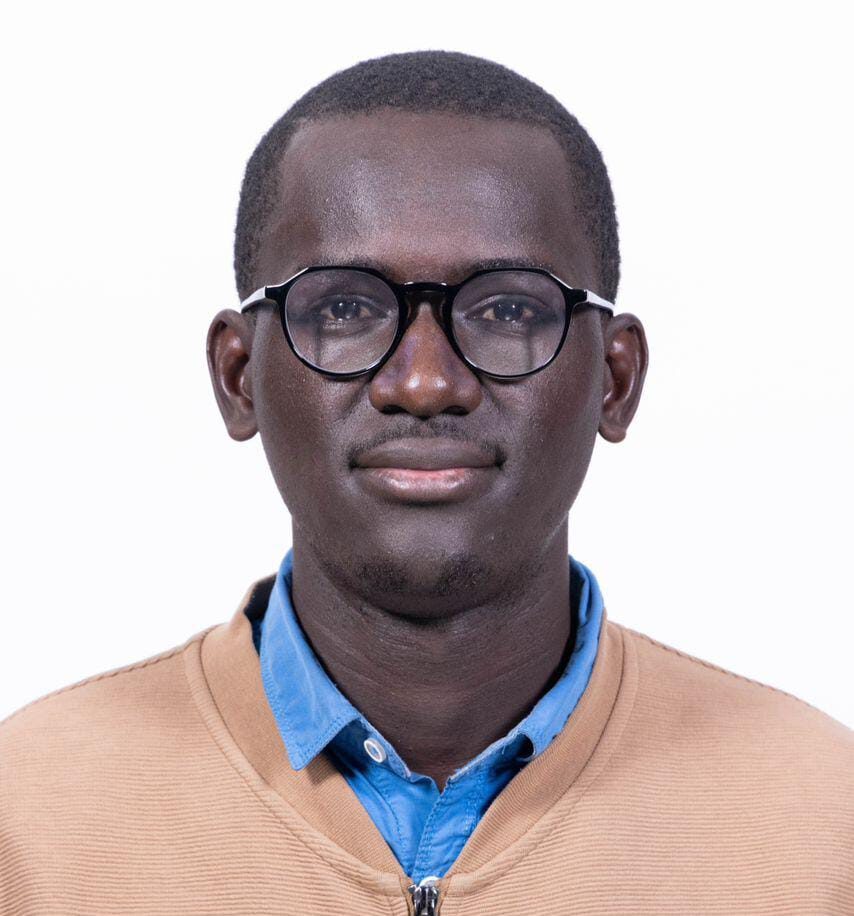Estimé en premier lieu à 99,67 % du PIB à fin 2023 par la Cour des comptes, puis à 119% du PIB à fin 2024 par le gouvernement dans son dernier rapport sur la stratégie de la dette à moyen terme alors qu’il a été arrêté à 132% par le FMI, le niveau d’endettement public du Sénégal ne cesse d’alimenter les débats et les controverses. Si la dette publique est souvent présentée comme une question économique, financière voire politique, elle demeure une problématique foncièrement juridique. Est une dette publique ce que le droit qualifie comme telle. De ce point de vue, la notion de dette publique est définie sommairement par le règlement n° 09/2007/CM/UEMOA portant cadre de référence de la politique d’endettement public et de gestion de la dette publique dans les Etats membres de l’UEMOA comme la « dette résultant d’emprunts contractés par l’Etat ou ses démembrements auprès d’entités résidentes et/ou non ». Partant, il convient de reconstituer la dette publique en relevant successivement ce qu’est une « dette » et quand cette dernière devient « publique ».
La dette…
Conformément à la règlementation susvisée, la dette serait constituée d’emprunts, un emprunt désignant un contrat par lequel une personne obtient, l’usage d’une somme d’argent avec des conditions financières de remboursement. On retrouve dans cette catégorie la dette bancaire (plus de 2 milliards à fin 2024, selon la SDMT 2026-2028), la dette contractée en monnaie locale dans le marché financier sous-régional (Bons et obligations du Trésor), les emprunts auprès du FMI ou de la BOAD, la dette concessionnelle et semi-concessionnelle, les eurobonds, les crédits à l’exportation, etc. A se limiter à cette considération, la dette contractée ressort bien évidemment à 23 666,8 milliards (mds) de FCFA soit 119% du PIB. Cependant, cette définition est simpliste et lacunaire car elle ne prend pas en compte d’autres formes d’engagements financiers, non constitutifs d’emprunts, engagements desquels résultent pour les personnes publiques une obligation de payer.
S’il y’en a plusieurs, il peut être utile d’en citer deux : les garanties d’emprunt d’une part et les partenariats public-privé d’autre part. Pour les premiers, le règlement relatif à l’endettement des Etats membres de l’UEMOA semble témoigner d’une préoccupation par rapport aux garanties accordées par l’Etat ou ses démembrements. L’article 12 tend à limiter ces garanties en disposant que « chaque Etat membre s’interdit de fournir sa garantie pour des prêts dont les conditions sont plus onéreuses que celles de ses propres emprunts » sauf cas exceptionnels.
Cette disposition ne traduit néanmoins une prise en compte adéquate du niveau de la dette garantie dans la dette publique. Le cas du Sénégal en constitue une preuve flagrante : alors que le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2025-2027 indiquait que le niveau de la dette garantie était de 570 milliards FCFA à fin 2023, la Cour des comptes constate que son niveau s’élève en réalité à 2 265,45 milliards de F CFA soit 4 fois plus. Le dernier DPBEP a encore estimé cette dette garantie à 1 343,35 milliards FCFA représentant alors plus de 5% de stock de dette à fin 2024. Il en va alors que ce dernier représente un grand risque en cas d’appel de la garantie.
S’agissant des PPP, ils permettent de desserrer la contrainte d’endettement en lissant la charge budgétaire d’un projet d’investissement donné tout en ne conditionnant pas son développement aux disponibilités budgétaires exercice après exercice.
Or, le recours à ce mode de financement est vivement encouragé par la nouvelle doctrine du ministère des finances sénégalais. En effet, sous le régime de la loi n° 2021-23 du 02 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé et sur avis conforme émis par le ministre des Finances et du Budget par lettre n°0046/MFB/CAB/CT.BS en date du 11 janvier 2023, le Sénégal a signé un contrat de ce type pour un projet entièrement financé par le partenaire privé mais assorti d’un loyer trimestriel évalué à environ 3,77 milliards FCFA. Dans ce contrat, les engagements de l’Etat sont estimés en moyenne à 65,3 milliards FCFA par an, soit un montant cumulé de 1 960,5 milliards FCFA sur la durée de 30 ans du contrat. Ces engagements constituent une dette de l’Etat envers le partenaire privé sans que cet engagement soit constitutif d’un emprunt.
Or, si le cadre juridique en exige l’étude de la soutenabilité, la forme d’endettement qui en résulte ne fait pas l’objet d’une consolidation dans la dette publique. Par comparaison, la dette publique consolidée au sens de Maastricht inclut bien les PPP pour les Etats membres de l’Union européenne. Par voie de conséquence, en rajoutant un certain nombre d’engagements financiers non constitutifs d’emprunts, la dette publique bondirait certainement.
… devient publique
Il ressort également de la règlementation susvisée de l’UEMOA que la dette devient publique lorsqu’elle est contractée par l’Etat et ses démembrements. Par Etat, il faut comprendre « administration centrale ». Par démembrement, le règlement vise les collectivités territoriales décentralisées d’une part et les organismes publics d’autre part. S’agissant des premières, une dette locale est quasi-inexistante car le recours à l’emprunt des collectivités territoriales sénégalaises est strictement encadré. Pour les secondes, est incluse dans la dette publique la dette des organismes publics dont l’Etat détient plus de plus de 50% du capital. Il s’agirait selon l’article 54 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) sénégalaise – outre les collectivités territoriales – des « établissements publics à caractère administratif », des « agences et autres structures administratives similaires ou assimilées » ainsi que des « organismes de protection sociale ». Ces organismes publics ont par exemple recouru à l’emprunt en 2024 pour un montant de 8 milliards.
C’est plus ou moins la même définition reprise par l’article 3 de la loi n° 2022-08 du 19 avril 2022, sauf que cette loi distingue les organismes publics des sociétés publiques. Le cas échéant, se pose la question de l’intégration éventuelle de la dette propre aux sociétés publiques. Au vu du règlement de l’UEMOA, il semble bel et bien que cesdites sociétés doivent être intégrées, seulement pour celles dont l’Etat dispose plus de 50% du capital.
Tel est le cas de la dette des sociétés dites nationales, lesquelles sont des sociétés par actions de droit privé dont le capital est intégralement souscrit par l’Etat et, le cas échéant, par d’autres personnes morales de droit public, la participation directe de l’Etat étant nécessairement supérieure à 50% (Groupe La Poste SN par exemple) ; et les sociétés à participation publique majoritaire c’est-à-dire une participation publique supérieure à 50%. Dans ce second cas, pour que l’endettement d’une telle société soit inclus dans la dette publique, il faudrait que l’Etat détienne 50 % du capital et ne partage pas cette part avec une autre personne publique. Or, la dette de ces sociétés nationales et sociétés dites à participation publique majoritaire était estimée à fin 2024 à 2 446 milliards FCFA (DPEPB 2026-2028 en recensait 27).
En définitive, cette brève analyse rappelle que la reconstitution de la dette publique sénégalaise ne peut passer que par le droit, la question de son périmètre étant une question strictement juridique : partout dans le monde, la dette est ce que le droit en dit. Sous cet angle, il apparaît que la dette publique n’est pas seulement constituée par les emprunts de l’administration centrale (représentant le stock de la dette estimé à 119% du PIB) mais également par l’ensemble des engagements financiers, représentatifs d’emprunts ou non, contractés par l’Etat et ses démembrements, les entreprises publiques y comprises. Il en ressort alors qu’en évaluant la dette publique à 132% du PIB, le FMI s’avère plus proche du respect du droit que les estimations présentées dans les documents budgétaires de l’Etat, estimations limitant la dette publique à la dette de l’administration centrale et aux emprunts de celles-ci.
Et, en y rajoutant les autres engagements financiers de l’Etat et de ses démembrements, conformément à la décision n° 15688-(14/107) du conseil d’administration du FMI adoptée le 5 décembre 2014, le niveau de l’endettement public pourrait s’alourdir davantage.
Mor THIAM
Doctorant contractuel et Chargé d’enseignement, Université de Poitiers
Chercheur associé, Direction de la Recherche, INSP (ex-ENA)