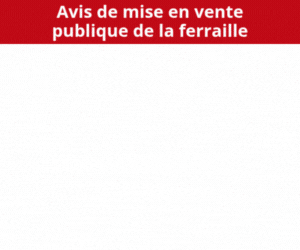Diplômé de l’Académie militaire française de Saint-Cyr Coëtquidan, le général de corps d’armée Babacar Gaye, a occupé d’importantes fonctions au Sénégal comme à l’étranger.
Il a été chef d’état-major général des armées du Sénégal ainsi que commandant de la force onusienne en République démocratique du Congo. Le général Gaye est une voix autorisée pour évoquer le départ envisagé des troupes françaises dans beaucoup de pays africains. Jean-Marie Bockel, envoyé personnel d’Emmanuel Macron en Afrique, a remis au président français son rapport sur la reconfiguration du dispositif militaire français en Afrique. Cela coïncide avec la décision du Tchad et, peut-être, du Sénégal de mettre fin à cette présence militaire française.
Croyez-vous à un désengagement total de l’armée française en Afrique ?
Il reste d’importantes implantations militaires françaises en Afrique ; je pense notamment à Port-Bouët, en Côte d’Ivoire, et à Djibouti. Un désengagement militaire total de la France en Afrique aurait, bien au-delà de sa dimension militaire, une très forte signification stratégique. Lors du départ des militaires français du Mali, des hommes politiques et des diplomates français, comme l’ambassadeur Araud, ont recommandé d’évacuer toutes les bases en Afrique francophone pour écrire de nouvelles relations avec les pays hôtes de ces bases. Alors, puisque vous me demandez ce qu’est ma conviction, je crois que la présence militaire française dans les pays de l’ancien pré carré est en sursis, mais que Paris s’efforcera de conserver sa pré sence à Djibouti.
La crise sécuritaire au Sahel et ses conséquences sur l’instabilité politique ainsi que la montée des discours souverainistes ont-elles eu des effets sur l’annonce de ce nouveau déploiement français en Afrique ?
Oui, incontestablement. La crise sécuritaire a eu un effet d’amplification et de déformation sur la relation Afrique-France. J’en veux pour preuve l’accueil triomphal réservé par les populations maliennes aux militaires français de l’opération Serval, accueil ponctué par la déclaration du président François Hollande à Gao. «C’est le plus beau jour de ma vie politique». Et huit ans après, le calvaire d’un convoi militaire de l’opération Barkhane partit d’Abid jan en direction du Niger à travers le Burkina Faso. C’est que l’opération Barkhane a été bien moins décisive que Serval et tous les ordres établis ont alors été bouleversés par les souffrances des populations : les troupes étrangères ont été sommées de quitter le Sahel, les autorités en place ont été renversées et les partenaires traditionnels ont été invités à revoir leurs méthodes. Le départ des troupes françaises ne remet pas en cause leur valeur, leurs efforts et leurs sacrifices, il est le symbole d’une page qui se tourne. Je conviens que dans certains cas, elle se déchire plus qu’elle ne se tourne.
Après le départ de la présence américaine au Niger et la réduction envisagée ou même le départ dans certains pays des effectifs de l’armée française en Afrique, n’y a-t-il pas des risques de laisser le terrain libre à des groupes paramilitaires comme ceux russes ?
Puisque les paramilitaires russes sont déjà au Sahel, il y a certainement un risque. Pour ma part, dans une interview donnée, en décembre 2021, à l’hebdomadaire « Jeune Afrique», le quotidien malien Le Challenger avait repris et publié à la Une ma déclaration suivante : «Il est tragique qu’un État en soit réduit à devoir faire appel à une société de sécurité privée» (jeudi 16 déc. 2021). Depuis la Résolution 2719 du Conseil de sécurité de décembre 2023, les opérations de paix de l’Union africaine peuvent être financées par les Nations unies. J’espère que dès que notre Organisation continentale aura un président de sa Commission, il se penchera sur les drames du Sahel et du Soudan qui sont liés.
Propos recueillis par Oumar NDIAYE