Dans « Sirène de la nuit », Lobé Ndiaye nous plonge au cœur de la vie d’une femme issue d’un milieu social modeste, dont la quête permanente du bonheur se heurte à une montagne d’illusions. Le roman, paru aux Éditions Les impliqués Éditeur en 2021, pose un regard cru sur la société sénégalaise avec son cortège de violences et de souffrances.
Avec son roman « Sirène de la nuit », l’auteure et réalisatrice Lobé Ndiaye donne raison au pianiste et compositeur romantique polonais Frédéric Chopin, pour qui « la simplicité est la réussite absolue ; elle émerge comme une récompense venant couronner l’art ». La beauté de cette œuvre trouve sa consécration dans la simplicité de son style. L’auteure, en proposant un roman d’une soixantaine de pages, va droit à l’essentiel. Elle ne s’attarde pas dans de longs passages descriptifs. L’on se réjouit ainsi d’une certaine fluidité dans le jeu des transitions, des phrases courtes et des figures de style bien choisies qui installent un certain confort de lecture.
« Sirène de la nuit » dépeint, avec une parfaite maîtrise, le quotidien de nos concitoyens dans une métropole qui pourrait s’identifier à toutes les autres capitales africaines (quartiers résidentiels, lieux huppés, ghettos). Il s’agit d’une sorte de conte urbain qui confronte les problèmes qui minent la société et qui ont pour nom violence, pauvreté, promiscuité, inceste, chômage, drogue, problèmes d’éducation… C’est un regard cru que Lobé Ndiaye jette sur la société sénégalaise.
La trajectoire d’Aminata, protagoniste de ce roman paru aux Éditions Les impliqués Éditeur en 2021, est emblématique de celle de jeunes filles démunies dont l’unique obsession est de s’extraire de la misère, quel qu’en soit le prix. Lobé Ndiaye ancre son récit dans une réalité crue en dépeignant le triste spectacle des quartiers après le passage de la pluie : « La ville grelotte après une pluie diluvienne qui s’est déversée sur elle. Les eaux remplissent les rues ainsi que les égouts. Certains animaux, chats, rats, souris, ont péri. La route, ruisselante, accueille les premiers ouvriers qui s’affairent à réparer les réseaux de canalisation afin de pouvoir évacuer assez vite les eaux… ».
Au domicile d’Aminata, en l’absence de son papa Yérim, monogame, père de neuf enfants, l’eau est rentrée dans la maison et a détrempé tous les bagages. C’est dans cette baraque de fortune que la jeune fille, à la beauté imposante, une Néfertiti des temps modernes, est condamnée à vivre avec ses frères et sa mère, Mouni. Celle-ci est obligée de vendre tous les jours des condiments au marché pour entretenir la famille, depuis que son mari Yérim, ancien gardien dans une entreprise de recyclage, a pris sa retraite.
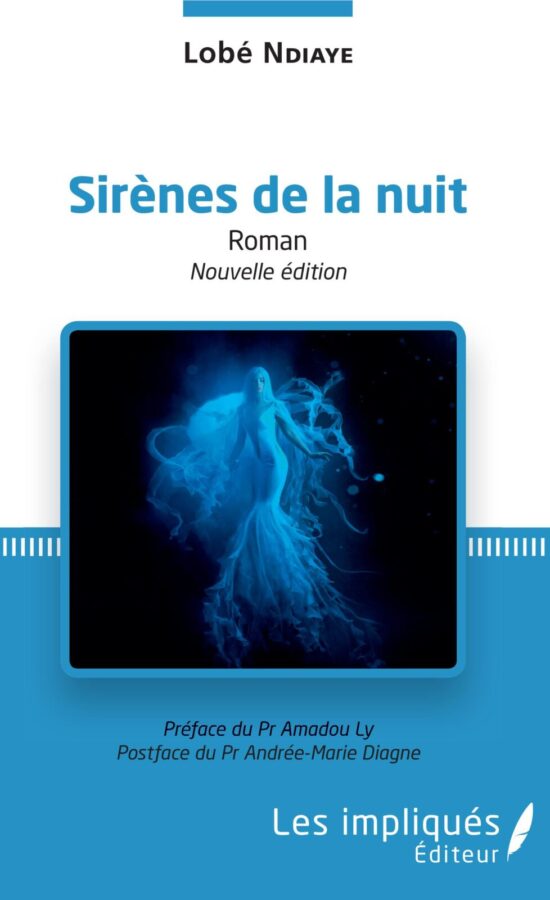
Si son frère Karim se procure de la drogue, Aminata tente d’entrer dans le milieu de la haute couture avec l’aide de Janine Tounkara, forte d’un riche parcours professionnel dans ce domaine. Elle lui fait découvrir la face cachée de la ville le soir : boîtes de nuit huppées et vie mondaine. Aminata cède alors à la tentation de l’argent facile. Elle entretient une relation avec Aladji Faty, le mari de Janine, qui l’épousera plus tard à tout prix. Janine est délaissée pour les beaux yeux d’Aminata et finit par quitter son ménage.
Mais ce mariage, conclu sans le consentement des parents de la jeune fille, marque le début d’une série de désillusions. Licencié de la société Auto Sénégal, où il était contremaître, le vieux Aladji sombre dans l’alcool et quitte définitivement la maison pour la rue. Aminata se retrouve dans la pauvreté, seule avec ses deux enfants. Son fils aîné, Moulay Faty, est contraint d’arrêter ses études en classe de Terminale pour aider sa mère.
Pendant ce temps, sa sœur Sarata, engrossée par un père ivrogne, échappe de justesse à la mort en donnant naissance à un bébé mort-né. Elle retrouve goût à la vie en épousant son professeur, Djibril Sall. Après de longues années, Aminata retrouve ses parents, qui acceptent de lui rouvrir les portes de leur baraque de fortune. Le bonheur de ces retrouvailles chasse ses « jours d’égarement » et ses « nuits troubles ».
À travers ce récit intense, Lobé Ndiaye brosse le portrait de personnages broyés par la ville, la vie et un système implacable. Il décrit des familles brisées par la pauvreté, l’alcool, l’inceste et le manque de repères solides. Le roman met en lumière le triomphe précaire d’une société profondément matérialiste. Dans cet univers bouillonnant et chaotique, l’auteure utilise des noms de figures historiques comme Alboury Ndiaye, Steve Biko, Thomas Sankara ou Mère Teresa pour nommer les rues et les bâtiments de sa ville fictive.
Lobé Ndiaye a produit environ 26 courts-métrages documentaires en coproduction avec le Conseil international des radios et télévisions francophones (Cirtf). Son second roman, « Une perle en éclats », a été distingué par le Grand Prix littéraire Dada Béhanzin au Bénin.
Ibrahima BA



