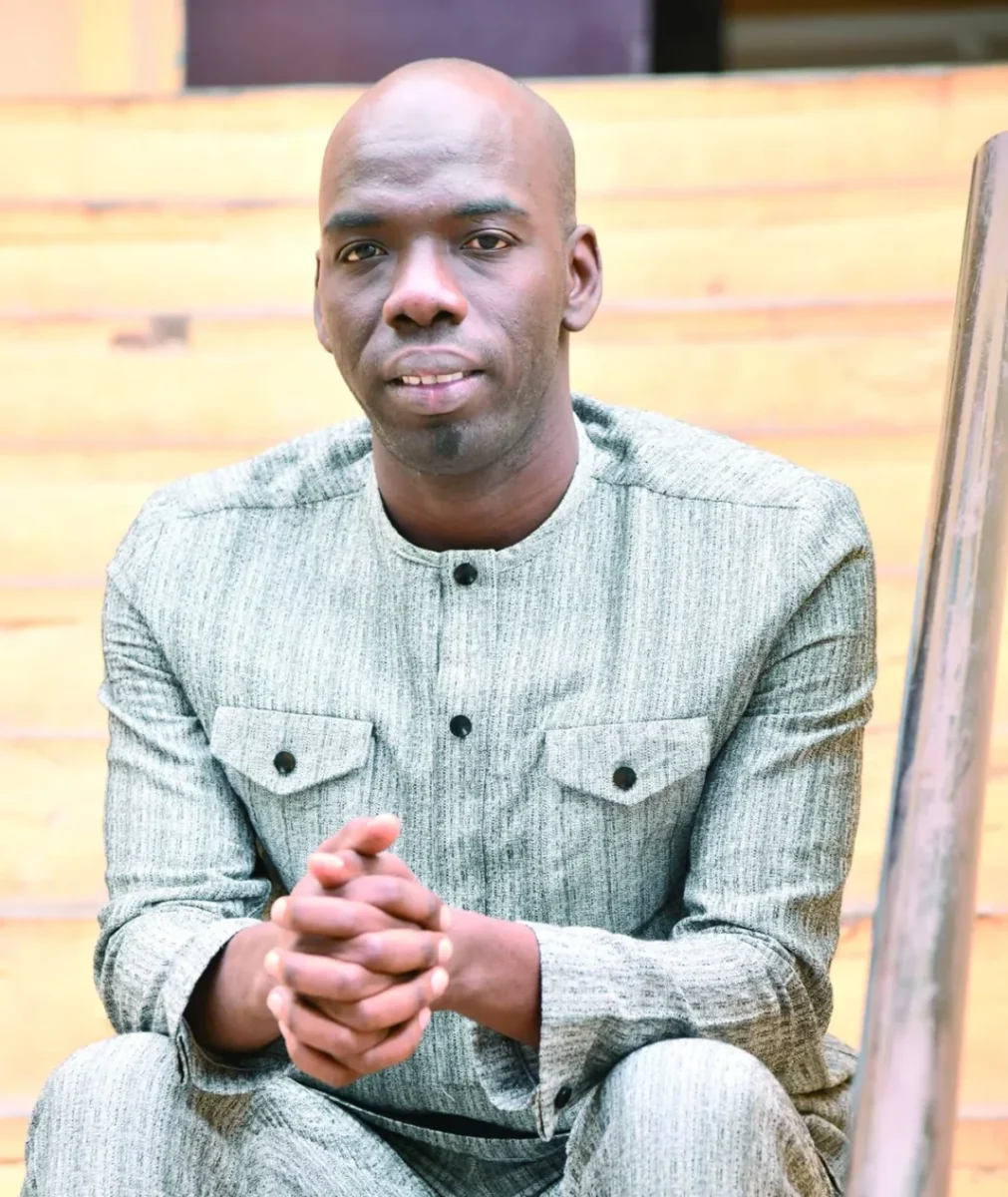Depuis le hublot, la forêt amazonienne apparaît d’abord comme une masse infinie, un tapis vert qui engloutit l’horizon. À mesure que l’avion descend, le paysage offre une mosaïque de verts profonds, de dômes serrés de canopée presque impénétrables. Ailleurs, il y a des clairières noyées de brume. Mais, cette immensité, partagée entre neuf pays, dont 60 % au Brésil, est, aujourd’hui, menacée par la déforestation, l’exploitation minière et agricole ou encore les feux de brousse. Le poumon de la planète étouffe depuis des années. Selon les données du gouvernement brésilien, près de 10 000 km² de forêts ont disparu en 2024 malgré une légère baisse par rapport à l’année précédente.
L’Amazonie est cruciale pour plusieurs raisons. Elle agit comme un régulateur climatique mondial majeur, un réservoir de biodiversité d’une ampleur exceptionnelle. De plus, elle abrite de nombreuses communautés humaines et des ressources en eau douce. Cette forêt absorbe aussi d’énormes quantités de dioxyde de carbone, maintient les cycles de l’eau et de l’humidité à travers le continent et abrite des millions d’espèces végétales et animales.
Souvent oubliée, l’Amazonie n’a jamais été aussi présente politiquement dans une négociation climat. À Belém, elle n’a pas servi de simple décor exotique pour diplomates en gilet bleu. Elle a été le sujet, l’enjeu et la bataille en attendant des accords la concernant. Depuis des décennies, l’Amazonie incarne les contradictions du développement : poumon vital, mais convoité par l’agrobusiness ; sanctuaire de biodiversité, mais grignoté par les mines et le soja. Pour la première fois, la Cop a mis ces contradictions sur la table sans détour. Le Brésil, pays hôte, a surpris non par de grandes envolées lyriques, mais par des annonces concrètes. Il s’agit de l’extension des zones protégées, du renforcement du financement dédié à la surveillance forestière, de la coopération accrue avec les autres pays amazoniens et de l’engagement clair à ramener la déforestation à un niveau proche de zéro. Il y a encore peu, une telle ambition aurait paru naïve. Désormais, le réalisme montre que sans l’Amazonie, la bataille climatique est perdue.
Les peuples autochtones, eux, ont gagné en visibilité en étant de véritables architectes de solutions. Leur message, simple et implacable, a traversé les salles de négociation. Protéger la forêt implique d’abord de protéger ceux qui y vivent. Leurs territoires sont, aujourd’hui, les zones les mieux préservées du continent, preuve que la conservation passe par la reconnaissance des droits. Ce qui distingue surtout cette Cop 30, c’est le déplacement du centre de gravité. Habituellement, tout tourne autour du carbone, des marchés, des gigatonnes. À Belém, la conversation s’est enracinée dans le réel. La forêt a pris la même place que le climat et l’économie. Rien n’est acquis pour autant. Le Brésil devra démontrer que ces promesses survivront aux alternances politiques. Les financements devront suivre et les lobbies ne devront pas étouffer les engagements avant qu’ils ne germent. L’Amazonie reste un géant blessé. Elle est capable de se régénérer, mais aussi de basculer. Le monde est prévenu. Où que l’on soit, en Europe, en Afrique, en Asie ou en Amérique, la protection de cette forêt doit devenir un combat commun. Comme l’a rappelé Farhana Yamin, avocate et militante climatique, chacun doit se transformer en « activiste du climat ». De la même manière, il faut se tenir debout pour préserver l’Amazonie. Pour la Cop 30, l’Amazonie a, enfin, été reconnue comme un acteur central de l’équilibre climatique mondial.
bgdiop@lesoleil.sn