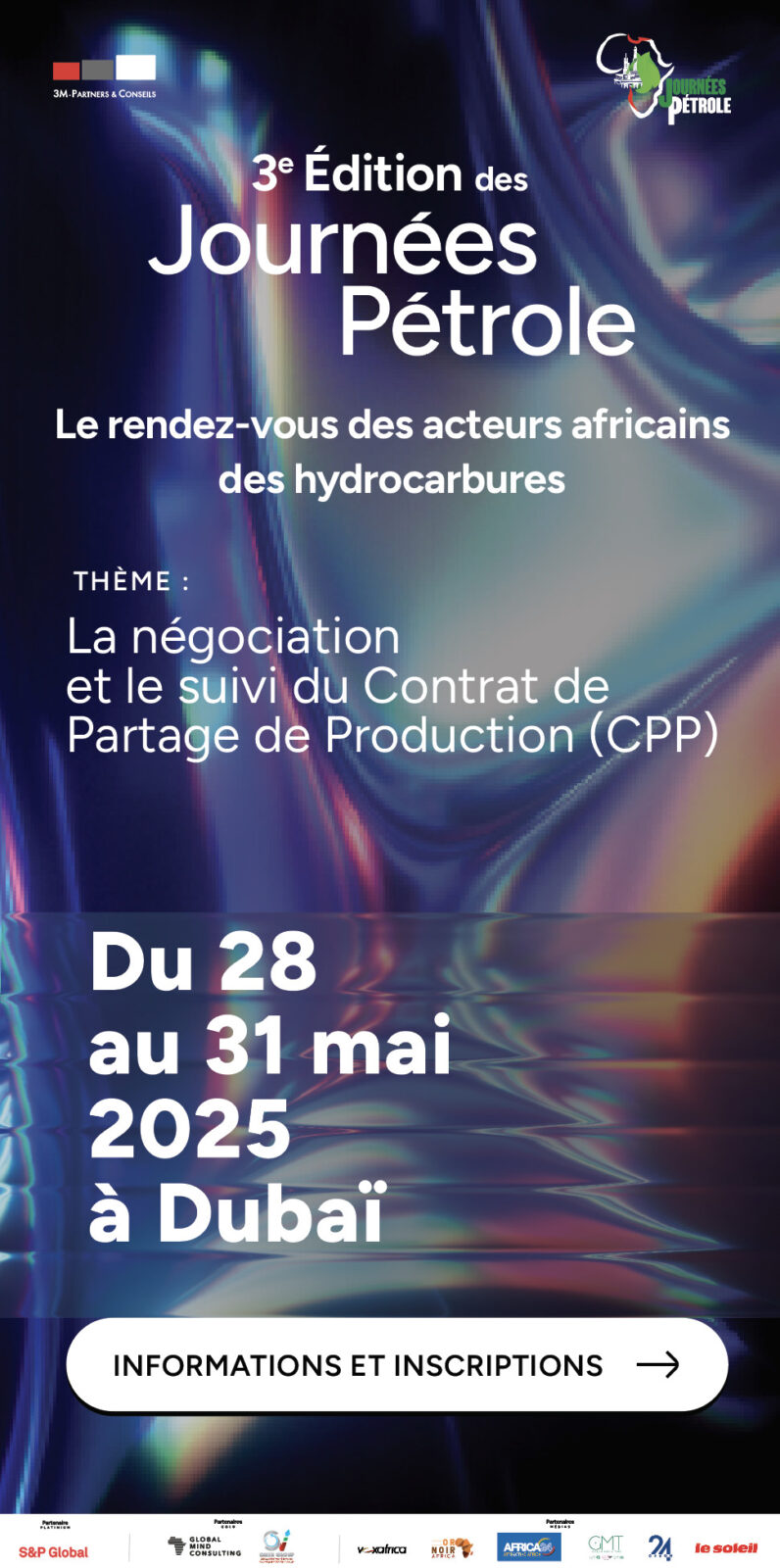Depuis 1992, l’État a initié une série de dialogues politiques avec l’opposition, la société civile et les forces vives de la Nation. Aux yeux d’une grande partie de l’opinion, ces forums républicains ont plus servi à faire avancer le calendrier politique du régime en place que d’obtenir de réelles avancées sur le plan démocratique.
Le dialogue a toujours été une panacée pour les différents régimes qui se sont succédé au pouvoir au Sénégal. À la suite des troubles post-électoraux de 1988, le Président Abdou Diouf décide de mener des concertations dans le but d’apaiser le climat politique. Ainsi, à la fin de l’année 1991, le Parti socialiste (Ps), au pouvoir, et une dizaine de partis de l’opposition (Pds, Ld/Mpt, Cdp/Garab Gui, Aj/Pads…) décident la mise en place d’une Commission cellulaire chargée de la réforme du Code électoral. Dirigée par le juge Kéba Mbaye, elle a permis d’obtenir de grandes avancées dans le fonctionnement du système électoral sénégalais.
Il s’agit d’une quinzaine de réformes, dont l’identification obligatoire de l’électeur avec sa carte d’identité ; l’abaissement de la majorité électorale de 21 à 18 ans ; le passage obligatoire à l’isoloir ; l’utilisation de l’encre indélébile ; la limitation des mandats à deux ; la présence de représentants des candidats dans les bureaux de vote ; la présence d’un représentant des partis dans la Commission de distribution des cartes d’électeur ; le découplage de l’élection présidentielle et des élections législatives, etc. Par ailleurs, d’autres mesures, telles que l’élection présidentielle à deux tours si aucun des candidats n’a la majorité absolue au premier tour, ont été aussi actées à l’issue des échanges.
L’héritage du Code Kéba Mbaye
L’Assemblée nationale, à travers le vote de la loi n° 92-16 du 7 février 1992 portant Code électoral modifié, va ainsi figer dans le marbre les nouveaux articles du Code électoral qui vont conduire à la première alternance politique en 2000. Ce Code consensuel est aussi connu sous le nom de « Code Kéba Mbaye ». Commission nationale de réformes des institutions (Cnri) Pour sa part, la Commission nationale de réforme des institutions, alors dirigée par l’ancien directeur général de l’Unesco Amadou Mahtar Mbow, aujourd’hui disparu, a été instaurée par le décret n° 2013-730 du 28 mai 2013 ordonnant à la Cnri de mener la concertation nationale sur ladite réforme et de formuler des propositions visant à améliorer son fonctionnement. Cette Cnri est née des Assises nationales.
Ainsi, la Cnri, composée de personnalités, dont d’anciens hauts fonctionnaires, d’universitaires, de juristes, d’experts et de membres de la société civile, a émis un certain nombre de recommandations comme la réforme du régime politique avec un passage à un régime parlementaire rationalisé, la réorganisation des pouvoirs du président de la République de manière à contenir son pouvoir et une meilleure inclusion des langues nationales dans les processus de décisions institutionnelles. Concernant l’organisation des élections, la Cnri avait proposé la création d’une Autorité électorale indépendante ; l’inscription électorale locale obligatoire ; le respect strict du calendrier républicain ; la révision du Code électoral via consensus, etc.
Les recommandations de la CNRI restées lettre morte
La Cnri remettra son rapport, le 14 février 2014, au président Macky Sall qui, contrairement aux recommandations qu’elle a émises, va opter pour le maintien d’un système présidentiel fort qui va aboutir à la suppression du poste de Premier ministre en 2020. Selon beaucoup d’observateurs, le dialogue sous Macky Sall apparaît comme une vitrine communicationnelle pour son régime dans l’optique de favoriser des mesures politiques comme la loi sur le parrainage, l’ouverture de la majorité présidentielle… Dialogue post-référendum de 2016, absence de consensus Ainsi, les différents dialogues qui ont eu lieu depuis 2016 semblaient avoir pour but de régler des problèmes de candidatures plutôt que des avancées démocratiques. Concernant la première édition du Dialogue tenue en 2016 et mise en œuvre deux mois après le référendum constitutionnel du 20 mars 2016, les revendications de l’opposition concernant l’arrêt Ousmane Ngom (interdiction de manifester dans certaines zones de Dakar), la révision du fichier électoral et le statut de l’opposition n’ont pas été validées à l’issue des discussions. Ce, faute de consensus. Un autre Dialogue a été lancé en 2017 sans qu’aucune avancée majeure ne soit notée. Ce manque de confiance a été exacerbé, en 2018, par le vote de la loi sur le parrainage malgré le rejet de l’opposition.
Cette démarche a accentué la méfiance des organisations de la société civile et des partis politiques de l’opposition sur la pertinence de ces concertations. Le Dialogue initié en 2019, après la présidentielle, fut confié à Famara Ibrahima Sagna, ancien ministre de l’Économie et des Finances sous Abdou Diouf. Il fut alors nommé président du Comité de pilotage du Dialogue national. Cette rencontre avait pour but, selon plusieurs spécialistes, de servir de prétexte pour « cautionner » l’ouverture politique vers les anciens libéraux (Modou Diagne Fada, Idrissa Seck et Oumar Sarr) et le mouvement « Osez l’avenir » d’Aïssata Tall Sall en novembre 2020. Toutefois, d’après Moundiaye Cissé de l’Ong 3D, le bilan de ce dialogue n’est pas aussi négatif. « Les précédents dialogues nous ont permis d’avancer sur certains nombres d’acquis, tels que l’élection du maire au suffrage universel direct et la revue du parrainage, le montant de la caution et la suppression du parrainage aux locales. Chaque dialogue a son lot de résultats », affirme-t-il.
Modification du Code pour écarter Karim Wade et Khalifa Sall
En 2020, les principaux points de discorde entre l’opposition et la majorité restent inchangés. La suppression du parrainage, réclamée par une partie de l’opposition, l’instauration du bulletin unique et la création d’une haute autorité chargée de l’organisation des élections demeurent toujours des points de discorde entre le pouvoir et l’opposition. En outre, l’opposition dénonçait la modification du Code électoral qui impose aux candidats de jouir de leurs droits civiques pour figurer sur les listes électorales et être candidats à l’élection. Une disposition perçue comme un moyen d’écarter les candidats Karim Wade et Khalifa Sall de la présidentielle de 2019.
Dialogue de 2023, processus d’isolation d’Ousmane Sonko
Le Dialogue de juin 2023 a connu quelques avancées à l’instar de l’abaissement de la fourchette du nombre de parrains entre 0,6 % à 0,8 % du fichier électoral, soit entre 44 231 et 58 975 signatures, ou la possibilité d’avoir le parrainage des députés et des élus territoriaux. Toutefois, il est finalement apparu aux yeux de beaucoup d’observateurs comme une opération visant à réhabiliter Karim Wade et Khalifa Sall dans leurs droits civiques et politiques. Ainsi, à la suite de ces concertations, l’Assemblée nationale va acter la modification des articles L28 et L29 du Code électoral, lesquels rétablissent dans leurs droits ces deux leaders politiques qui ont bénéficié d’une grâce présidentielle tout en ayant déjà purgé leur peine. Ces derniers qui avaient fait l’objet de condamnations avant d’être graciés par Macky Sall étaient désormais éligibles à la présidentielle de mars 2024. Ousmane Sonko (Pastef) qui avait décliné l’invitation au Dialogue national a été condamné à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse et à six mois avec sursis pour diffamation. Ces peines vont pousser le Conseil constitutionnel à invalider sa candidature pour la présidentielle de 2024.
Le Dialogue de février 2024, l’échec du report de l’élection
Le dernier Dialogue national a été convoqué le 26 février 2024 après le report surprise du scrutin du 3 février 2024, à quelques heures du démarrage de la campagne officielle. Au terme des travaux de deux jours, la date du 2 juin 2024 a été proposée pour la tenue de la présidentielle par les participants. En outre, le président sortant, Macky Sall, dont le mandat s’achevait le 3 avril 2025, a été autorisé par le Dialogue à rester en poste jusqu’à l’installation de son successeur.
Les conclusions des concertations prévoyaient aussi le maintien de la liste des 19 candidats déjà retenus par le Conseil constitutionnel, le réexamen complet des dossiers de candidatures, avec la vérification de l’exclusivité de la nationalité sénégalaise, et le projet de loi d’amnistie introduit pour son adoption à l’Assemblée nationale dès le jeudi 29 février 2024. Toutefois, les conclusions du Dialogue seront invalidées, le 15 février, par le Conseil constitutionnel qui va annuler le décret d’abrogation du décret convoquant le corps électoral et le report de la présidentielle adoptée par l’Assemblée nationale le 5 février. Ainsi, Macky Sall sera forcé de tenir les élections dans les « meilleurs délais » avant la fin de son mandat, le 3 avril 2024, permettant ainsi la tenue de la présidentielle le 24 mars 2024.
Mamadou Makhfouse NGOM