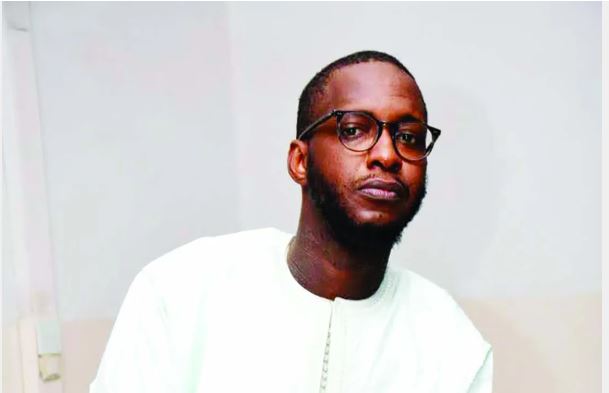En plus d’être un ensemble géographique anxiogène, l’Afrique de l’Ouest est aussi homogène dans ses dynamiques politiques et sécuritaires. Les crises qui l’ont secouée depuis plus de trois à quatre décennies n’ont pas été localisées dans un seul pays.
Elles ont eu des ramifications entre plusieurs États jusqu’à devenir des dynamiques de conflits avec un arc de crise traversant toute la sous-région. Au début des années 1990, un processus de démocratisation a été amorcé, suite à la Conférence de la Baule, où le Président de la France d’alors, François Mitterrand, avait enjoint la poursuite de l’aide au développement à une ouverture démocratique. S’ensuit après l’ère des Conférences nationales qui ont permis à beaucoup de cette aire géographique d’humer l’air de la démocratie. En même temps, dans un autre versant de l’Afrique de l’Ouest, la zone de Mano River connaîtra des rébellions sanglantes et des coups d’État à répétions dans des pays comme le Liberia, la Sierra Leone.
Il aura fallu attendre le début des années 2000 pour voir un autre processus de démocratisation être amorcé dans notre sous-région avec des alternances démocratiques et de transitions politiques pacifiques suite à des élections. Le Sénégal donnera ainsi l’exemple avec l’arrivée au pouvoir de Me Abdoulaye Wade. En Guinée-Bissau aussi, le même processus est noté, de même qu’en Côte d’Ivoire avec Laurent Gbagbo.
Cette période semblait faire ancrer notre espace sous-régional dans une dynamique démocratique qui allait crescendo. Aujourd’hui, tous ces efforts menés depuis trois décennies par des dynamiques internes d’une forte société civile, de médias, de jeunesses engagées et aussi de pressions externes, risquent d’être vains. Comme depuis 1990, les dynamiques politiques et sécuritaires sont d’une telle homogénéité et d’anxiété qu’il faut craindre pour notre espace sous-régional.
En 4 ans, quatre coups d’État, au Mali, Burkina, Niger, Guinée, ont été dénombrés. Cette poussée de fièvre hémorragique se présente avec les mêmes signes avant-coureurs, les mêmes symptômes. Ainsi, un vrai phénomène de vases communicants. Du Mali au Niger en passant par le Burkina Faso, la même raison est invoquée pour justifier la prise du pouvoir par les militaires : la détérioration de la situation sécuritaire face au terrorisme djihadiste. Comme si cette question n’est pas de la responsabilité des Forces de défense et de sécurité dont c’est la mission principale de défendre l’intégrité territoriale.
Ces putschistes, comme s’ils s’étaient passé le mot, évoquent les maux de l’ingérence étrangère, principalement de la France, sous des accents souverainistes. Ce souverainisme est ainsi à géométrie variable avec l’invitation d’autres puissances comme la Russie via ses groupes paramilitaires et sociétés minières, à venir suppléer dans les mêmes formes, ce que dénoncent les putschistes dans l’approche de leurs pays « à disposer d’eux-mêmes ».
L’autre trouvaille de ces juntes militaires, c’est d’avoir des poussées totalitaristes en étouffant toutes les voix discordantes. C’est pourquoi il n’est pas étonnant de voir tous ces pays procéder à des interdictions de diffusion de médias étrangers et nationaux ainsi de l’embastillement et l’embrigadement de tout leader politique ou d’opinion ayant des positions contraires. Il est nécessaire, aujourd’hui, de chercher à savoir comment trouver le garrot qui va arrêter cette hémorragie du putschisme qui risque de nous faire revenir à un état de coma démocratique.
Pour l’implémentation de la démocratie en Afrique de l’Ouest, il a fallu de longues luttes menées par certaines formations politiques, les sociétés civiles, les médias, avec l’appui de l’extérieur. Il doit en être de même pour mettre fin au putschisme, avec la conjugaison de dynamiques internes aidées en cela par des pressions internationales. Sinon notre espace sous-régional voguera et tanguera entre putschisme, souverainisme (à géométrie variable), populisme, et si nous ne prenons pas gars, vers un totalitarisme.