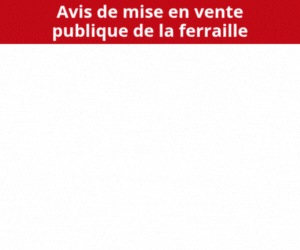Le Canada s’est résolu à approfondir ses relations avec le Sénégal présenté comme un partenaire « fiable et sûr ». Son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire l’a confirmé dans le cadre d’un entretien réalisé dans sa résidence. Selon Marcel Lebleu, le Canada accorde une attention particulière aux priorités du gouvernement sénégalais et entend faciliter la mobilité des personnes dans le respect des procédures établies par les deux pays. Il s’est aussi prononcé sur d’autres sujets d’actualité.
Excellence, vous êtes au Sénégal depuis le mois de septembre. Pourriez-vous nous dire, d’emblée, quelles ont été vos premières impressions sur notre pays ?
Je dois rappeler que j’ai commencé ma carrière de diplomate en Afrique et que j’ai occupé le poste de directeur-général Afrique de l’Ouest et du Centre au sein d’Affaires Mondiales Canada (Ndlr : appellation du ministère des Affaires étrangères au Canada) depuis 2021, avant de venir au Sénégal, un pays que j’aime beaucoup. On peut dire que c’est un choix éclairé. J’ai présenté mes lettres de créance au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye en octobre dernier. J’ai eu, à ce moment-là, la possibilité de suivre le déroulement des élections législatives anticipées. Nous avons beaucoup apprécié cette transition démocratique qui s’est faite dans le calme et la tranquillité. Il y a eu quelques soubresauts, mais ce scrutin s’est bien déroulé. Je me réjouis aussi de l’installation de la nouvelle Assemblée nationale, on va pouvoir commencer à travailler de plus près avec le gouvernement. Le Canada est présenté comme un partenaire privilégié de plusieurs pays africains. Pour certains, le Sénégal occupe une place de choix dans ce cercle de partenaires.
Qu’en est-il réellement ?
Effectivement, nous entretenons avec le Sénégal des relations diplomatiques très profondes. C’est l’un des rares pays d’Afrique qui n’a jamais connu de coup d’Etat et qui a toujours assuré des transitions démocratiques. Nous considérons qu’il est un partenaire fiable et sûr.
Il faut le dire, nous suivons de très près tout ce qui se passe dans la sous-région et le Sénégal est perçu comme un pôle de stabilité. En tant qu’Envoyé spécial pour le Sahel, je porte une attention particulière au rôle joué par le Sénégal dans les discussions entre la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) et l’Alliance des États du Sahel, composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger, qui ont annoncé leur retrait le 29 janvier prochain. Nous suivons attentivement ces discussions et nous saluons la posture du Président de la République Bassirou Diomaye Faye et de son émissaire. Le Sénégal présente-t-il des atouts par rapport à certains pays africains ? Absolument. Une des valeurs fondamentales de la politique étrangère du Canada porte sur l’expression de la démocratie, laquelle dépasse le simple exercice électoral. Elle a trait à la gouvernance, la consultation électorale, l’indépendance du système judiciaire, pour ne citer que ceux-là. Le Sénégal dispose de piliers solides tant du côté du système judiciaire que sur le plan institutionnel.
La mise en œuvre effective des décisions prises par les différents tribunaux et juridictions compétentes en est un exemple concret. C’est important pour nous car nous estimons que les valeurs démocratiques et le respect de l’Etat de droit constituent des leviers essentiels pour assurer le développement de toute nation. Ces fondements solides, combinés aux perspectives économiques du pays, rendent le Sénégal particulièrement attractif. Il présente notamment un attrait particulier avec l’émergence de son secteur énergétique. En tant que pays disposant d’une expertise considérable dans le domaine des hydrocarbures, le Canada suit avec intérêt les développements dans ce secteur.
Nous avons une expérience précieuse à partager, notamment en matière de gouvernance des ressources naturelles, de normes environnementales et de formation technique. Il est tout aussi important de souligner que le Canada a une politique internationale féministe. Nous investissons beaucoup sur les questions d’égalité de genre, mais nous avons constaté malheureusement, s’appuyant sur un rapport du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), que le Sénégal occupe le 130e rang sur environ 175 pays. Donc, il y a beaucoup à faire. Le Sénégal serait-il un mauvais élève en matière de respect des droits de la femme ? Je dirais plutôt qu’il y a du travail à faire. Si on se base sur ce classement, le Sénégal n’est pas sur le podium. Il doit intensifier ses efforts pour dépasser ce stade. Lors d’une visite effectuée en Casamance, dans le cadre de la campagne des 16 jours d’activisme visant à mettre fin aux violences basées sur le genre, les statistiques ont peint un tableau préoccupant.
Mais cette situation n’est pas spécifique au Sénégal, même au Canada, il y a des efforts à faire. Au niveau de la représentation des femmes au Parlement, le Sénégal a enregistré des avancées notables comparé à d’autres pays. Il a fait, sur ce plan, mieux que le Canada. Une loi sur la parité a été adoptée favorisant une meilleure représentativité féminine au niveau des fonctions électives. Mais il est important de promouvoir des mesures pour combattre certaines pratiques traditionnelles comme les mariages forcés et les mutilations génitales féminines, qui persistent dans certaines localités du pays. J’ai, par ailleurs, été impressionné par le rôle des guides religieux et par la contribution des leaders communautaires dans le plaidoyer porté par les femmes.
Il a aussi été retenu d’intégrer la dimension genre dans les politiques publiques, votre appréciation par rapport à cette approche du Sénégal ?
Elle s’applique à tous. Nos projets de coopération sont étudiés sur cette base. Nous développons aussi des programmes qui appuient directement les communautés et les mouvements associatifs de femmes. Par exemple, dans le cadre du Programme bilatéral du Canada au Sénégal, 60,67 millions de dollars ont été engagés en 2022-2023. Il s’agit du principal canal de programmation de notre coopération avec le Sénégal. Il se concentre sur trois piliers : l’amélioration de l’accès équitable à une éducation et à des services de santé de qualité pour les filles, les femmes et les autres populations vulnérables, en mettant fortement l’accent sur l’éducation, la nutrition, la santé et les droits sexuels et reproductifs ; la création d’opportunités économiques durables pour les femmes et les autres populations vulnérables, y compris dans le domaine de l’action climatique ; et l’avancement des droits humains et de la gouvernance inclusive, en mettant l’accent sur l’avancement des droits des femmes et des filles et en veillant à ce que les services soient adaptés à leurs réalités. Le programme fournit une partie de son aide sous forme d’appui budgétaire sectoriel en éducation, ce qui permet au Canada de soutenir directement le gouvernement sénégalais. Mais nous travaillons également avec d’autres pays dans le cadre des projets multilatéraux.
L’ensemble de notre contribution avoisine les 100 millions de dollars par année. C’est l’occasion pour moi de souligner le travail remarquable mené avec l’Institut Pasteur au niveau du développement de la production locale des vaccins. Nous avons collaboré étroitement pour apporter des réponses adéquates durant la crise sanitaire de la Covid, particulièrement dans le contexte où la souveraineté vaccinale a été évoquée.
Un des axes majeurs de votre partenariat avec le Sénégal porte sur l’éducation. Pouvez-vous nous en dire plus ?
L’éducation est au cœur des interventions du Canada au Sénégal depuis les années 1960. Des investissements de plus de 335 millions de dollars (soit plus de 149 milliards de FCfa) dans le secteur depuis 2007 ont positionné le Canada comme l’un des plus importants bailleurs de fonds bilatéraux pour l’éducation dans le pays. Notre soutien continue à contribuer de manière structurante et durable aux changements systémiques et à directement accompagner les réformes nationales, telles que l’adoption de l’approche par les compétences, la promotion des femmes enseignantes à des postes de responsabilité et le renforcement des structures de gestion déconcentrées du système éducatif.
L’engagement du Canada dans le secteur de l’éducation a été renouvelé avec la signature en 2023 de l’initiative Réussir, un appui budgétaire sectoriel d’une valeur de 49,35 millions de dollars (près de 22,3 milliards de FCfa) pour soutenir la mise en œuvre du Programme national d’éducation. Grâce à l’inclusion de Réussir dans sa requête pour accéder à des allocations du fonds à effet multiplicateur du Partenariat mondial pour l’éducation, aux côtés des appuis budgétaires de la coopération japonaise, de l’Agence française de développement et de l’Union européenne, le Sénégal a pu mobiliser le maximum auquel il avait droit, soit 40 millions de dollars américains. Grâce à ces investissements et un important dialogue de politiques, le Canada joue un rôle significatif dans les efforts de réduction de la pauvreté au Sénégal. Nous accordons une importance majeure à la formation, un levier essentiel pour le développement. La question centrale est de voir comment préparer les jeunes aux métiers qui répondent aux besoins du marché du travail. Nous nous intéressons de plus en plus à la formation technique : par exemple comment réparer des panneaux solaires comme ceux installés à la Résidence officielle, assurer la maintenance etc. C’est ce type de formation dont le Sénégal a besoin. On ne valorise pas assez ces métiers-là.
Nous estimons que c’est paradoxal au vu du taux de chômage noté au Sénégal. Mais il est important de préciser que cet appui budgétaire en éducation est conditionné par certains objectifs de développement. On évalue les progrès en matière de respect des droits humains, de gouvernance, de démocratie. Des exigences sont posées au niveau macroéconomique. Nous suivons attentivement la situation fiscale de l’État, mais ce sont surtout les indicateurs de rendement qui nous intéressent : les taux de réussite scolaire, le maintien des étudiants dans le système universitaire. Le tableau est positif pour le Sénégal depuis plusieurs années. Nous sommes très satisfaits de cet appui que nous fournissons maintenant à très peu de pays.
Le Canada aurait-il pris des mesures restrictives à l’encontre de certains pays africains ?
Le Canada a suspendu quelques accords de partenariats bilatéraux dans la sous-région. Je vous ai indiqué en début d’entretien que nous accordons beaucoup d’importance à la gouvernance démocratique et au respect des règles de transparence.
Nous avons dû rompre des conventions de partenariat avec des pays africains qui font fi de ces principes. Dans ce contexte régional complexe, nous pensons que le rôle stabilisateur du Sénégal est crucial. Le Canada apprécie particulièrement la position équilibrée et constructive du Sénégal dans les défis sécuritaires régionaux. En tant qu’envoyé spécial pour le Sahel, je peux témoigner de l’importance du leadership sénégalais dans la recherche de solutions aux crises régionales. Le Canada est disposé à renforcer son appui au Sénégal dans ce rôle, notamment à travers des programmes de formation et de renforcement des capacités en matière de sécurité et de maintien de la paix, comme notre appui au Sénégal à l’Initiative Elsie pour la participation des femmes aux opérations de paix.
Dire que le Sénégal a traversé des périodes sombres frôlant même une impasse politique, ces dernières années, peut-on considérer qu’il a réussi à maintenir son statut de démocratie majeure ?
Absolument. À l’image des autres pays, nous étions préoccupés par ce climat de tensions qui a régné pendant quelques années. C’était une situation très particulière pour nous. Je me trouvais, à l’époque, au Canada et nous suivions de près l’actualité politique au Sénégal. C’était une situation un peu chaotique mais nous sommes arrivés à bon port. Je pense qu’au final le Sénégal a été à l’honneur. Il a su se relever. Je l’ai dit au Président de la République Bassirou Diomaye Faye lors de notre rencontre. J’ai également tenu à adresser mes vives félicitations à tous les Sénégalais pour la réussite de cet exercice démocratique.
Les instances juridiques comme les acteurs du processus électoral ont tous joué un rôle déterminant. Le pays a traversé des moments difficiles mais nous espérons que c’est derrière nous et que le Sénégal va se projeter dans l’avenir avec plus de sérénité avec le régime qu’ils ont élu. Avec l’avènement du nouveau régime, peut-on s’attendre à un nouveau tournant ? Notre engagement envers le Sénégal s’inscrit dans la durée. Notre appui, qui va au-delà du système éducatif, est estimé à 100 millions de dollars par année. Le Canada est depuis longtemps un partenaire privilégié et influent du gouvernement sénégalais en matière d’aide au développement. Nos deux pays vont célébrer cette année 63 ans de partenariat.
Depuis 1962, les investissements du Canada en matière d’aide au développement s’élèvent à près de 1,3 milliard de dollars, dont près de 913 millions de dollars au cours de la dernière décennie seulement. En 2022-23, le Canada a versé 138,91 millions de dollars canadiens d’APD au Sénégal, tous canaux confondus. On peut s’attendre à un approfondissement d’une coopération bilatérale déjà très dynamique… Je souhaiterais voir une plus grande présence d’investisseurs des deux côtés, un intérêt accru des exportateurs canadiens mais surtout des investisseurs canadiens.
À titre d’exemple, nous avons actuellement une entreprise qui finalise ses études de faisabilité technique pour un important investissement dans le secteur minier. Au-delà de ces aspects économiques, nos domaines d’intervention restent fortement axés sur l’éducation, notamment à travers nos programmes de bourses. Nous offrons environ 90 bourses par année, et nous constatons une présence croissante d’étudiants sénégalais au Canada. Cette mobilité illustre parfaitement ce que nous appelons la diplomatie de peuple à peuple – « people to people » en anglais. La communauté sénégalaise, estimée entre 8 000 et 10 000 personnes, est désormais bien établie dans différentes provinces du Canada et contribue activement au renforcement de nos liens bilatéraux.
Le Canada est devenu une destination privilégiée des Sénégalais. Quelle est votre appréciation ?
Une de nos priorités, c’est le recrutement d’immigrants francophones. Le Canada est un pays qui accueille environ 500.000 immigrants par année. On peut les classer en plusieurs catégories. Il y a ceux qui souhaitent s’installer dans les milieux minoritaires francophones notamment à l’extérieur du Québec essentiellement. Pour revitaliser certaines communautés francophones, nous encourageons les destinations vers le Manitoba ou le Nouveau-Brunswick. L’année dernière, nous avons octroyé près de 10.000 visas. Nous offrons trois types de visas : les visas des travailleurs, les visas d’immigration, ce qu’on appelle les résidents permanents et les visas temporaires de tourisme et d’études. La plus grande catégorie, c’est ce qu’on appelle les visiteurs estimés à 8.500 environ.
Pour les étudiants, 900 ont été dénombrés contre 300 pour les travailleurs. J’en profite pour dire que plusieurs entreprises canadiennes recherchent des compétences très prisées comme les soudeurs, les mécaniciens, les frigoristes. Il est reproché à votre pays de contribuer à la fuite des cerveaux en recrutant un personnel qualifié… Je ne partage pas cet avis. Nous avons reçu, la semaine dernière, SE-BEC-CAN, qui est un réseau d’affaires québécois-canadien-sénégalais. Il est constitué, en majorité de Sénégalais qui ont étudié et travaillé au Canada. Ils ont acquis des compétences et des connaissances leur permettant d’investir dans leur pays.
Ils sont rentrés avec un nouvel état d’esprit, un nouveau style d’entreprenariat. Ils contribuent de façon active au développement du Sénégal. Je trouve importante cette démarche surtout qu’on évolue dans un monde globalisé. C’est important que les gens diversifient leurs expériences. Dans le milieu des affaires, l’expérience canadienne est très valorisée, car elle est fondée sur une culture axée sur la solution. Nous optons pour la promotion de l’entrepreneuriat dans la mesure où les entrepreneurs offrent des opportunités d’emplois aux jeunes.
Par ailleurs, les Sénégalais, qui décident de rester au Canada, vont continuer à envoyer des fonds à leurs familles respectives. C’est le cas pour la très forte communauté Mouride établie au Canada par exemple. Elle fait des levées de fonds importantes. Les immigrés sénégalais restent très attachés à leur pays. Je pense qu’il faut voir cela sous l’angle d’un partenariat gagnant-gagnant. Les émigrés mettent leurs expériences au service de leurs communautés.
On parle de vitalité de la coopération bilatérale. Et depuis la prise de fonction des nouvelles autorités étatiques, on a l’impression que des partenaires techniques et financiers optent pour la prudence, quelles perspectives s’offrent avec le Canada ?
Nous sommes là pour accompagner le Sénégal. Si nous avons nos priorités en matière de politique étrangère, notamment la politique féministe que j’ai évoquée, ce qui guidera nos actions, c’est notre accompagnement du gouvernement dans la mise en œuvre de sa Vision Sénégal 2050. Ce n’est pas à nous de dicter les priorités du Sénégal, même si nous mettons en avant nos valeurs. Je pense qu’il est toujours nécessaire d’engager des discussions entre partenaires. Nous privilégions des projets que nous voulons développer mais c’est toujours dans l’optique de contribuer aux priorités du gouvernement sénégalais.
Le Premier ministre Ousmane Sonko a décliné, il y a quelques jours, devant l’Assemblée nationale, sa feuille de route lors de la Déclaration de politique générale. Qu’est ce qui a vous le plus marqué dans son programme ?
Nous avons suivi avec beaucoup d’intérêt la Déclaration de politique générale du Premier ministre. Plusieurs aspects ont retenu notre attention, notamment l’accent mis sur la bonne gouvernance, la transparence et la lutte contre la corruption. Ces principes rejoignent les valeurs que nous défendons dans notre coopération avec le Sénégal. J’ai également noté avec satisfaction l’importance accordée à la formation professionnelle et technique des jeunes, un domaine dans lequel le Canada dispose d’une expertise reconnue et où nous sommes déjà engagés, comme je l’ai mentionné précédemment. La volonté affichée de moderniser l’administration et de digitaliser les services publics ouvre également des perspectives de collaboration intéressantes.
Que pensez-vous de son élan souverainiste (réciprocité des visas, fin de la dépendance extérieure et des accords jugés désavantageux pour le Sénégal, entre autres ?)
Notre relation avec le Sénégal, vieille de 63 ans, est basée sur le respect mutuel et l’intérêt réciproque. Comme je l’ai souligné plus tôt, nous privilégions une approche qui consiste à accompagner le Sénégal dans la réalisation de ses propres priorités de développement. Concernant la question des visas, nous maintenons un dialogue constant avec les autorités sénégalaises pour faciliter la mobilité des personnes dans le respect des procédures établies par nos pays respectifs.
Quelles sont les opportunités d’affaires pour les investisseurs sénégalais ?
Je tiens à souligner que le Canada offre un environnement d’affaires particulièrement favorable aux investisseurs sénégalais. Nos provinces présentent des opportunités diverses et complémentaires et les communautés francophones au Canada constituent des portes d’entrée naturelles. Les secteurs des technologies vertes, du numérique et des services constituent des créneaux porteurs. J’encourage vivement les entrepreneurs sénégalais à explorer ces possibilités. L’exemple du réseau SE-BEC-CAN que j’ai évoqué précédemment montre bien le potentiel de ces échanges économiques entre nos deux pays. Nous souhaitons voir davantage d’initiatives similaires se développer dans les années à venir.
Le Sénégal s’apprête à quitter le cercle des pays les moins avancés. Qu’est-ce que cela va changer selon vous ?
L’amorce du processus en vue du retrait du Sénégal en 2029 de cette catégorie est importante car elle reflète la trajectoire positive du Sénégal et sa volonté de se positionner comme un acteur économique majeur en Afrique de l’Ouest. Pour le Canada, j’y vois une opportunité d’approfondir nos relations bilatérales. Bien sûr, notre coopération au développement restera importante – je l’ai souligné tout à l’heure en parlant de nos différents engagements de longue date et qui continuent, mais cette graduation ouvre aussi la voie à un partenariat plus équilibré, notamment sur le plan économique.
Les entreprises canadiennes, qui manifestent déjà leur intérêt pour le marché sénégalais comme je l’ai mentionné concernant le secteur minier, devraient être encore plus encouragées par ce nouveau statut qui témoigne d’un environnement économique dynamique. Cette transition nous permet aussi de miser sur une plus grande collaboration dans des domaines d’avenir comme l’innovation technologique, la transition énergétique ou l’économie numérique – des secteurs où le Canada dispose d’une expertise reconnue. Le Sénégal dispose désormais davantage d’atouts significatifs pour attirer des investissements de qualité, et nous souhaitons accompagner cette dynamique positive.
Entretien réalisé par Matel BOCOUM (textes) et Ndèye Seyni Samb (photos)