Le débat sur la toponymie de nos rues refait surface avec des élus locaux qui ont procédé au changement de noms des rues dans certaines villes à l’image de Dakar. Ndiouga Benga, professeur d’histoire à l’Ucad, a, lors d’un entretien accordé à la rédaction du Soleil, rappelé les aspects historiques de la toponymie des rues au Sénégal.
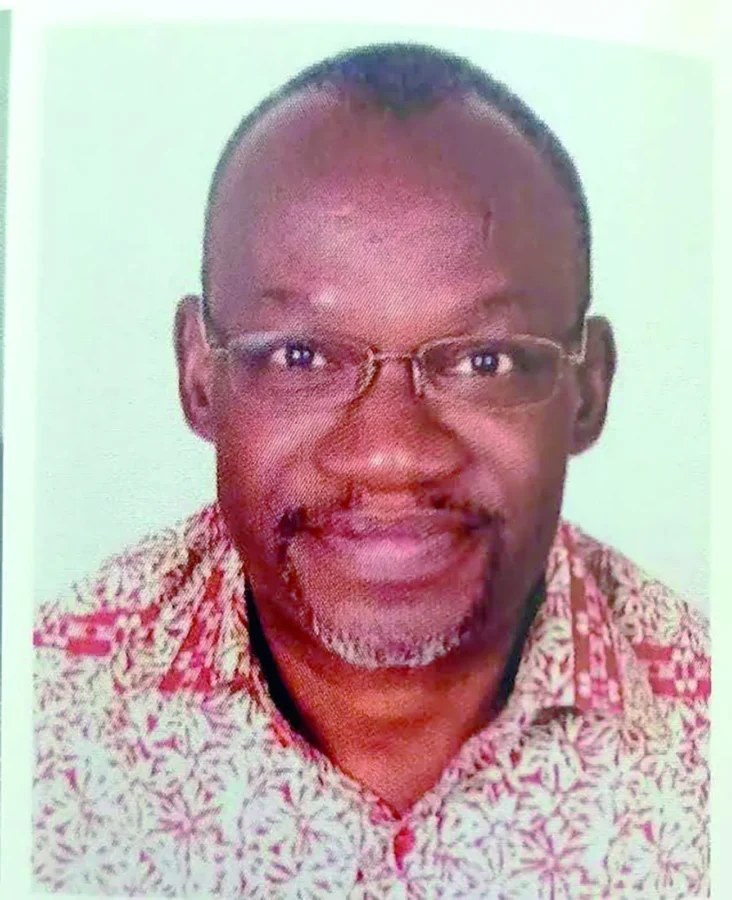 À Dakar, le maire Alioune Ndoye a procédé au changement de noms des rues pour honorer de grandes figures du pays. En quoi cela peut impacter sur l’affirmation identitaire tout en coupant le cordon ombilical avec notre passé colonial ?
À Dakar, le maire Alioune Ndoye a procédé au changement de noms des rues pour honorer de grandes figures du pays. En quoi cela peut impacter sur l’affirmation identitaire tout en coupant le cordon ombilical avec notre passé colonial ?
Je ne suis pas convaincu qu’il faille user des expressions « identitaire » ou de « rupture avec le passé colonial ». Elles sont très ambivalentes et mouvantes. L’histoire coloniale est la nôtre, si polémique soit-elle dans les débats en tous genres. Elle a été nombre de rues du centre-ville de Dakar (le Plateau, la ville européenne) portent encore leur affiliation coloniale. Il n’y a pas eu de politique vigoureuse de débaptisation des rues après les indépendances, mais des modifications mineures. La nomination coloniale des rues et sites avait peu changé. La ville est restée élitiste avec une dépendance politique et culturelle. L’État postcolonial a absorbé et adopté le système occidental pour nommer les rues, même si progressivement elle rendit hommage aux grands hommes : Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop, Nelson Mandela…
Le phénomène de rebaptisation des rues a pris de la vigueur à partir de Feu Mamadou Diop, maire de Dakar dans les années 1980 : Pinet-Laprade (Djily Mbaye), Blanchot (Moussé Diop), Roume (L S Senghor), Ponty (Pompidou), Sarraut (Hassan 2). Dans un autre registre, 65 ans après les indépendances, nous avons abandonné notre propre modèle d’immatriculation de véhicules par exemple, 1022 S1A ou DK 1680 BA, selon l’époque, pour adopter celle à la française, AA 632 WQ. Un retour du colonial ?
Comment voyez-vous cette décision historique et quelle analyse faites-vous de la dénomination des rues au Sénégal par rapport à son histoire ?
Nommer ou changer le nom d’une rue ou d’une avenue, dans le périmètre communal, relève de la prérogative du Conseil municipal. Il n’y a rien de nouveau ni d’inédit. Par contre, l’espace est une clé de compréhension cruciale pour interroger la culture et l’idéologie coloniales. Comment créer à Dakar et dans d’autres villes, un espace socioculturel, identitaire, différent de celui du colonisé, rappelant celui-là même laissé en Métropole. La toponymie coloniale joue un rôle-clé dans l’aliénation des populations indigènes de la ville. Elle exclut l’historicité et les identités africaines de la sphère urbaine. Il fallait discipliner et l’espace conquis (travaux de voirie et d’aménagement) et les hommes (déplacements et déguerpissements dont celui de mai 1914 à Dakar, suite à l’épidémie de peste, au lendemain de la victoire de Blaise Diagne à l’élection pour la députation).
La dénomination des rues et des sites dans le Plateau (quelques 38 noms), des années 1860 aux années 1880, à la suite de la mise en place d’un plan d’urbanisme dès juin 1862, fit appel à 3 référents : d’abord, les héros de la période de la pacification (lutte contre les pouvoirs maraboutiques : Canard, Blanchot, Dagorne, Mage, Vincens; contre les maladies : docteurs Thèze, Parchappe, Raffenel) ; ensuite, les sites créés par la colonisation : rues du cimetière, de l’hôpital, de la gendarmerie, de l’administration ; enfin, des noms africains (Thiong, Niomre, Carone, Kaolack, Sandiniery, Dialmath, Médine, Tann) renvoyant à des victoires françaises lors de la conquête coloniale. À noter que peu de place est accordé aux Africains : avenue Malick Sy et deux originaires citoyens français, avenue Blaise Diagne et rue Ambroise Mendy. Dans la Médina, la ville africaine, les rues étaient numérotées (n°1 à 71), jusqu’à la veille des indépendances. La ville indigène n’est pas un élément intégral de la ville coloniale ; l’imaginaire indigène ne faisait pas partie de la représentation coloniale.
Comment doit-on faire pour que la toponymie des rues soit un moyen d’incarnation de notre propre histoire afin de réconcilier les populations et leur espace ?
Il faut préciser que si l’administration procéda à un « marquage » de la ville pour rappeler que le colonisateur était le maître, les colonisés qui y vivaient avaient leur propre manière de la codifier par une dénomination alternative défiant la vision européenne (Parka, Difoncé dans le Plateau et surtout dans la Médina, Angle Ndioba, Angle Goumba, Gouye Mariama Layene…).
Il s’ensuivait une rencontre entre deux types de codification de l’espace : celui du colonisateur et celui du colonisé, avec les intérêts et les expériences des usagers ; la terminologie locale fonctionnant à côté de la terminologie européenne. Maintenant, il faut éviter de faire de l’espace public le « bien » exclusif des politiciens et des religieux. Que fait-on de ces hommes et femmes de notre société, par exemple, les hommes de culture (comme Pape Mamadou Samb Papisto Boy, Oumar Ndao, Issa Samb, Joe Ouakam et son Kër sur la rue Jules Ferry), les femmes sont à placer au centre de nos questionnements, les acteurs des pratiques du quotidien et des mouvements sociaux, ceux et celles qui célèbrent la créativité populaire.
En somme, il ne faut pas y avoir des noms de rues seulement pour ceux qui furent jadis les victimes de la domination coloniale, mais également il en faut pour ceux et celles qui, aujourd’hui, endurent les effets globaux du postcolonialisme et de la mondialisation, tout en réinventant un destin proprement africain, cosmopolite et non élitiste à une population autochtone, dans la ville, site d’émancipation. En tant qu’historien, que proposez-vous pour avoir une politique nationale de dénomination de nos rues ? Il faut informer et être inclusif.
C’est la municipalité qui procède à la nomination ou à la débaptisation de rue ; elle n’est pas obligée d’y associer qui que ce soit. L’enjeu est triple : le premier, tourne autour du besoin de mémoire et d’histoire. Ce serait bien de recueillir, dans ce genre d’initiative, l’avis des historiens pour expliquer, avec rigueur et objectivité, même de voir si les citoyens sont intéressés ou indifférents à cette question, et d’autres acteurs, dans la diversité de leur engagement. Ce travail doit toucher toutes les collectivités locales du pays, en y intégrant la vision panafricaine et en dépassant la clôture coloniale et patriarcale. Le second enjeu a trait, au-delà de nommer une rue ou non, au « massacre » du patrimoine urbain qui n’a cessé que dans un passé récent, de Dakar à Matam et partout ailleurs. Les ministères dédiés, notamment ceux de l’Urbanisme et de la Culture et son sous-secrétariat sont interpelés. Le troisième, c’est comment « faire communauté », comment forger la nation avec ses « grands hommes » et ceux oubliés des micro-terroirs qui peut-être parlent plus aux populations.
Propos recueillis par Bada MBATHIE



