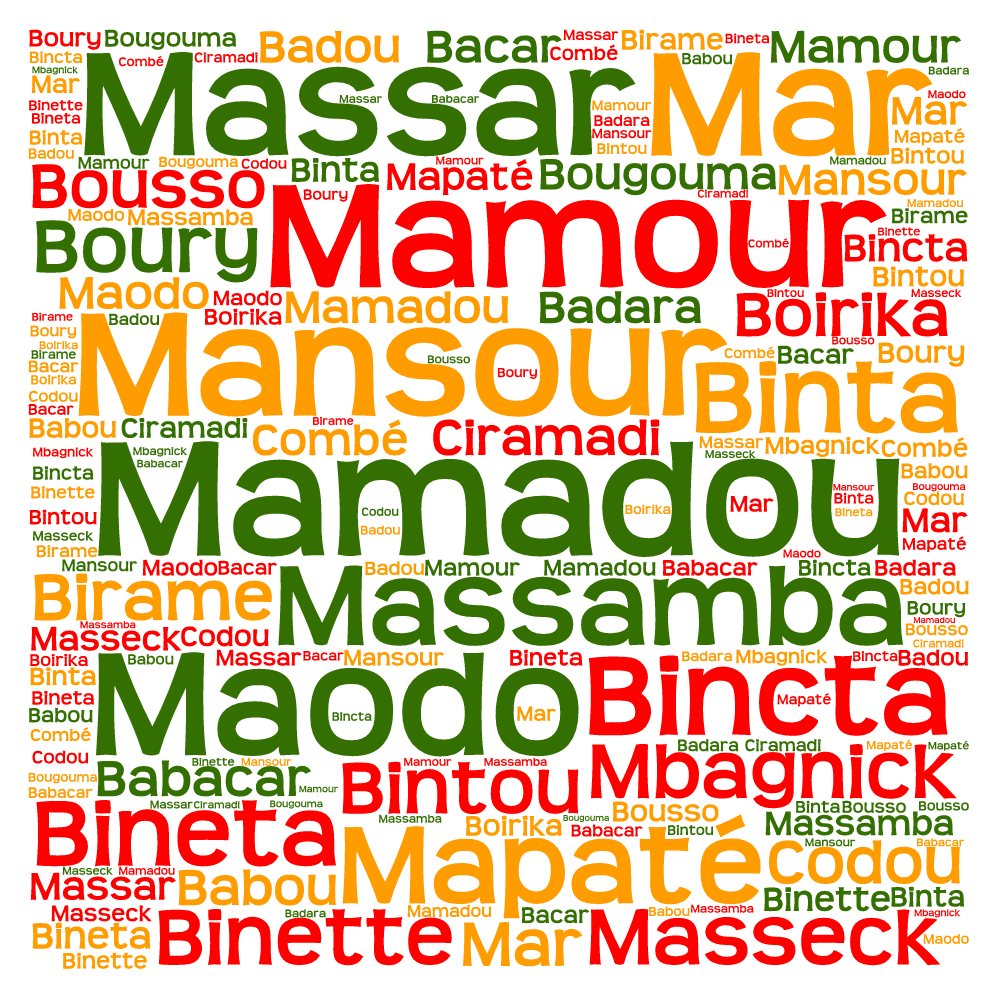Un prénom raconte une histoire. Il est la première note dans la vie d’un enfant, le définit et le caractérise. Mais derrière cette dénomination se cache tout un mythe, selon les ethnies, car elle en dit plus que ce qu’elle veut montrer. Au-delà de permettre de faire la distinction entre un tel et un tel, le nom constitue l’identité de chacun de ses membres du Peul au Sérère en passant par le Wolof et le Diola. Les religions révélées ont aussi joué leur partition dans le choix de ces dénominations souvent si singulières.
« Quel est ton nom ? », demande le surveillant en le fouettant sans pitié, et l’esclave de répondre : « Mon nom est Kunta Kinte », les pieds et les mains attachés. Le fouet s’abat de nouveau sur lui, jusqu’à ce qu’il dise que son nom est Toby et non Kunta Kinte. Cette scène de l’épisode 1 de la mini-série sur l’esclavage Roots (Racines), sortie dans les années 1970, montre l’attachement de Kunta Kinte à son nom de naissance. Cela reflète son appartenance ethnique et ses origines, dont il n’était pas prêt à se départir pour adopter le nom Toby, choisi par son maître. C’est ce qu’a aussi voulu montrer feu Abass Diao dans son mémoire d’études publié à l’École nationale supérieure des bibliothèques en France, dans les années 80, sur l’étude des noms sénégalais. Le prénom est, d’après l’auteur, un signe d’appartenance ethnique. De ce fait, il remplit différentes fonctions. Il y a, selon lui, tout un symbolisme autour de la grossesse de la femme, de la naissance et autour du nom donné à l’enfant. Cela explique les choix des prénoms que l’on retrouve uniquement dans une ethnie bien donnée et dans un contexte précis.
Talisman contre la faucheuse
Bougouma (je ne t’aime pas), Amul Yakaar (sans espoir), Ken Bugul (personne n’aime), Biti Loxo (l’extérieur de la main), Yadikoon (tu étais venu) ou encore Sagar (tissu sans valeur) sont autant de prénoms qui, à première vue, font sourire et peuvent même susciter des moqueries, car inhabituels, voire rares. Mais le prénom est un boubou qu’on peut difficilement enlever. Malgré leur singularité, ils revêtent un sens particulier. Ndeye Codou Fall Diop explique que ces dénominations ont la même source. L’enseignante en écriture wolof au Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti) renseigne que ces noms sont donnés à des personnes dont la mère accouche et que son enfant meurt de façon répétée ou perd des enfants en bas âge. Les prénoms dits « yaradaal » sont toujours présents dans la société wolof et sont des noms conjuratoires attribués à des enfants pour éviter leur mort précoce, dans un contexte familial de décès juvéniles à répétition.
Les anthroponymes antinomiques sont présents chez les Pulaar et sont destinés à « vaincre » la mort. « Nous avons des prénoms tels que Tekkere, assimilé à un morceau de tissu sans valeur, ou encore Ndoondi, qui veut dire cendre », affirme Papa Ali Diallo, spécialiste en sciences du langage. Il peut y avoir une motivation à l’antinomie pour décrédibiliser en apparence l’enfant et le dévaloriser. Mais cela représente, selon le linguiste, une stratégie pour assurer sa survie.
Les Sérères ont aussi des prénoms ayant trait à la mort comme Gaskel, Honan ou encore Nioowi. « On exorcise la mort en l’intégrant dans le nom du nouveau-né, pour tromper les forces de la mort », explique Sobel Dione, un adepte de la culture sérère aux textes très lus sur le réseau Facebook.
Felwine Sarr, Mouhamed Mbougar Sarr ou encore Léopold Sédar Senghor sont des noms familiers, et les personnes qui les portent ont brillé par leur intelligence. Mais derrière ces figures se cachent des anthroponymes lourds de sens. Felwine désigne celui qui est aimé de tout le monde, Sédar pour celui qui n’aura jamais honte, et Mbougar qui signifie celui qu’on n’aime pas. Ils tracent dès la naissance la trajectoire des bambins et influent sur leur vie. Dans la culture sérère, ces noms sont très répandus, d’après Sobel Dione. Le passionné de la culture sérère soutient que le prénom et le nom sont constitutifs de la personne dans cette ethnie. Il est plus qu’un signe, il est une figuration symbolique de la personne. « Le prénom situe l’individu dans le groupe, il représente le corps, l’âme, le totem », fait savoir ce dernier. Sobel Dione cite comme exemples des noms comme Ngor, qui veut dire le vrai homme, Sobel, qui signifie celui qui précède tout, Fakhane pour désigner la gentille, la tendre, Mossane, qui signifie la belle, ou encore Ñokhor, le bagarreur.
L’attribution du prénom intervient entre un et six ans chez les Diolas, d’après les explications de Paul Diédhiou. L’anthropologue de formation renseigne que cette singularité se traduit par le fait que, par le prénom, on peut appréhender les notions d’enfer, de paradis et de réincarnation. Ceci renvoie également à la singularité du prénom diola, qui « meurt » (kukét) avec la personne qui le porte si toutefois cette dernière décède à la fleur de son âge. « C’est un sacrilège que de nommer une personne qui meurt jeune. C’est pour cette raison que l’on prend la précaution de prénommer les enfants entre un et six ans », relève-t-il.
Lire aussi: https://lesoleil.sn/actualites/societe-fait-divers/dossier-2-3-jour-et-periode-de-naissance-un-temps-favorable-au-choix-du-prenom/
Une marque distinctive
Les qualificatifs des prénoms sont aussi retrouvés chez les Pulaars, avec des anthroponymes honorifiques tels que Ceernopour dire savant/enseignant, Elimaan pour dire imam. Selon les explications de Pape Ali Diallo, il existe dans ce même registre des appellations telles que Malaado, désignant celui qui est béni, Mawɗo, signifiant homme mûr, Cellu pour celui qui est en bonne santé, entre autres.
Gora pour brave homme, Serigne désignant savant, Gorgui signifiant homme mûr, Soxna pour désigner une épouse ou encore Magatte pour femme ou homme mûr sont autant de noms qualificatifs retrouvés chez les Wolofs.
Le prénom se basant sur un des traits de l’enfant est retrouvé également chez les Diolas. À titre d’exemple, Paul Diédhiou cite des noms tels que Djalissa, qui désigne un enfant chétif, Djamissa, qui signifie chétive pour une enfant, Akodji pour désigner le vilain ou encore Anatolediakaw pour la vilaine.
« Un des critères pour déterminer le moment à partir duquel on attribue un prénom à un enfant est la marche », explique Paul Diédhiou. L’enseignant-chercheur à l’Université Assane Seck de Ziguinchor relève que, lorsqu’un enfant sait réellement marcher ou courir, il peut se voir attribuer un prénom. Ainsi, jusqu’à ce stade, le bambin ne porte pas de prénom.
Arame NDIAYE