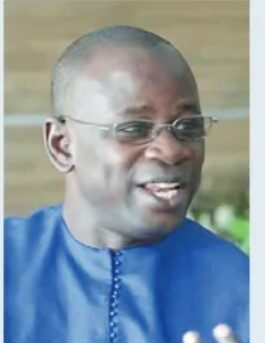À en croire le Pr Diakhaté, tout part d’une construction symbolique profondément enracinée dans nos sociétés : «Nous sommes dans des cadres sociaux organisés d’une certaine manière et qui mettent essentiellement l’accent sur l’idée que la femme garantit la vie.» Ainsi, dans l’imaginaire collectif,
l’homme incarne la matérialité : héritage, biens, ressources tandis que la femme est dépositaire de la continuité vitale.
Lire aussi : Des charlatans qui alimentent le feu (2/5)
De ce fait, dit-il, lorsqu’un décès survient, surtout s’il est jugé pré- maturé, le soupçon se tourne vers la veuve. «On place un doigt accusateur contre la femme en considérant qu’elle n’a pas garanti, comme il se devait, la vie de son mari ou de son enfant», souligne le sociologue. Une logique perverse qui, selon lui, associe la présence de l’épouse à une sorte de «bouclier protecteur contre la maladie, les épreuves ou même la mort. «Malheureusement, mal- gré la modernité, beaucoup profitent aujourd’hui de cette croyance dépassée pour nuire à la réputation d’autrui ou régler des comptes». C’est l’avis d’un chef de village qui préfère parler sous le couvert de l’anonymat. Cependant, pour le vieux D.S. du même village, la principale raison des accusations, de nos jours, reste les héritages convoités: «Les veuves sont souvent perçues comme des corps suspects: trop seules, trop pauvres, trop fragiles pour se défendre; elles deviennent des proies faciles. » Le décès du mari, déplore-t-il, ouvre non seulement la porte au deuil, mais aussi à la «convoitise ». L’accusation de sorcellerie, arme invisible et redoutable, poursuit-il, permet d’écarter la veuve tout en légitimant le pillage de ses biens. Ce chef de famille embouche la même trompette : « Le monde d’aujourd’hui est, hélas, dominé par la quête du matériel, et tous les moyens semblent permis pour s’en emparer. Et, dans les villages, quand le père laisse un héritage, ce sont surtout les veuves sans enfants pour les défendre qui deviennent les premières victimes. »
Adama NDIAYE