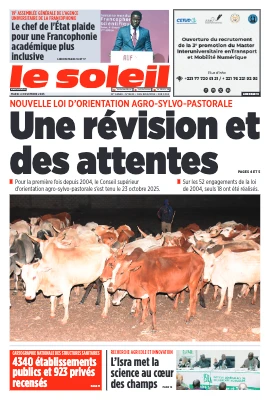Aux heures de pointe, une économie parallèle et ingénieuse prend le contrôle des artères congestionnées de Dakar. Loin des bus bondés et des taxis classiques, les « clandos », ces véhicules informels opérant sans licence, dessinent un réseau de transport aussi vital qu’illégal. Leur atout maître ? Un système de partage de trajet improvisé, où plusieurs clients, inconnus les uns des autres, se retrouvent à l’arrière d’une même voiture pour une course contre la montre, défiant au passage policiers et gendarmes.
Le phénomène n’est pas une simple dérive : il est une réponse pragmatique à l’asphyxie urbaine de la capitale sénégalaise, où la demande de mobilité excède largement l’offre publique.
Contrairement à l’image traditionnelle du taxi individuel, le clando moderne fonctionne sur le modèle du rabattage et du remplissage express. Le chauffeur, ou parfois un « coxeur » (rabatteur) posté aux points névralgiques, agglutine les clients au gré des feux rouges et des carrefours stratégiques. L’objectif est de saturer l’habitacle pour optimiser le rendement au kilomètre.
« Le principe est simple », explique Mamadou, qui utilise sa Toyota Corolla après son travail de bureau. « Sur l’axe Plateau–Parcelles, je ne prends jamais une personne seule pour un long trajet. Je remplis la voiture. Un client ici, un autre deux rues plus loin. Chacun paie sa part, mais au final, pour le même trajet, je multiplie mon gain. C’est ça qui me permet de gérer mon carburant et, plus important, ma dépense du lendemain. »
Ce système de covoiturage forcé et informel permet aux chauffeurs de maximiser leurs recettes sur les trajets les plus demandés. De leur côté, les passagers, bien que serrés, paient avant tout la promesse d’arriver à l’heure, un luxe inestimable dans une ville où l’immobilisme des embouteillages peut paralyser une demi-journée. Le clando s’érige ainsi en véritable catalyseur de l’activité économique personnelle.
Cette activité illicite ne pourrait exister sans une maîtrise parfaite de l’art de l’esquive et de la délation informelle. La relation entre les clandos et les forces de l’ordre est une danse quotidienne, un jeu de cache-cache où l’enjeu est une amende salée ou la confiscation du véhicule.
« On a l’habitude. C’est la pression », confie Mamadou, le regard aux aguets. « Un coup de fil, un message vocal dans un groupe WhatsApp crypté… Dès qu’un contrôle se profile, c’est la dispersion instantanée. On change d’itinéraire, on emprunte des ruelles, on traverse des marchés. Parfois, on fait même semblant de déposer un client pour faire croire qu’on est en famille. Il faut être inventif et réactif. »
Cette course-poursuite silencieuse est aussi vécue de l’intérieur par les passagers, souvent témoins malgré eux de ces manœuvres risquées. Ils sont pris entre le soulagement d’avancer et l’appréhension d’être immobilisés par une patrouille. Pour ces usagers, le choix est souvent cornélien : perdre un temps précieux dans des transports en commun officiels souvent défaillants, ou accepter les règles opaques et les risques du marché noir de la mobilité urbaine.
Pour l’État, la situation des clandos est un paradoxe politique et sécuritaire. D’un côté, il y a l’obligation de respecter la loi et de protéger les opérateurs de taxis et bus légaux, qui paient licences et taxes. De l’autre, il y a la réalité sociale : la répression totale paralyserait une partie significative des échanges urbains et provoquerait un mécontentement social majeur.
Malgré les efforts récents de modernisation du parc de transports publics (Bus Rapid Transit ou TER), l’informel reste crucial. Les forces de l’ordre opèrent donc souvent par vagues de répression, alternant avec des périodes de tolérance implicite. Cette tolérance est le prix à payer pour assurer une certaine fluidité dans la capitale.
Le phénomène clando dépasse la simple infraction routière pour devenir une composante majeure de l’économie de la débrouille à Dakar. Bien qu’informel, ce secteur génère des revenus substantiels pour des milliers de ménages, agissant comme un amortisseur du chômage des jeunes et des employés ayant besoin d’un complément de salaire.
L’argent circule rapidement :
• Revenus pour les chauffeurs : le système permet des gains quotidiens souvent supérieurs à ceux obtenus par un taxi légal après déduction des frais de licence.
• Emploi pour les coxeurs : les rabatteurs, souvent des jeunes sans emploi, trouvent une source de revenu en organisant le « remplissage » aux carrefours stratégiques.
• Pièces de rechange : l’entretien d’une flotte importante de véhicules (souvent anciens et peu coûteux) alimente l’activité des mécaniciens.
En définitive, le phénomène clando, avec ses trajets partagés et sa fuite perpétuelle, est le symptôme manifeste d’un système de transport public encore à la peine, incapable d’absorber l’urbanisation galopante.
Loin d’être de simples contrevenants, ces chauffeurs incarnent une forme d’ingéniosité face à l’urgence de se déplacer, comblant le déficit de l’État par la débrouille individuelle. Ils sont les « sauveurs » des temps modernes, palliant une carence structurelle en offrant de la rapidité et de la proximité là où les réseaux officiels manquent de densité et de fiabilité.
Ce jeu du chat et de la souris n’est pas près de s’arrêter. Il continuera de prospérer en marge de la légalité tant que l’offre légale ne répondra pas à la demande pressante de rapidité et d’efficacité qui pousse des milliers de Dakarois chaque jour dans les bras de ces opérateurs de l’ombre.
P.A.SY