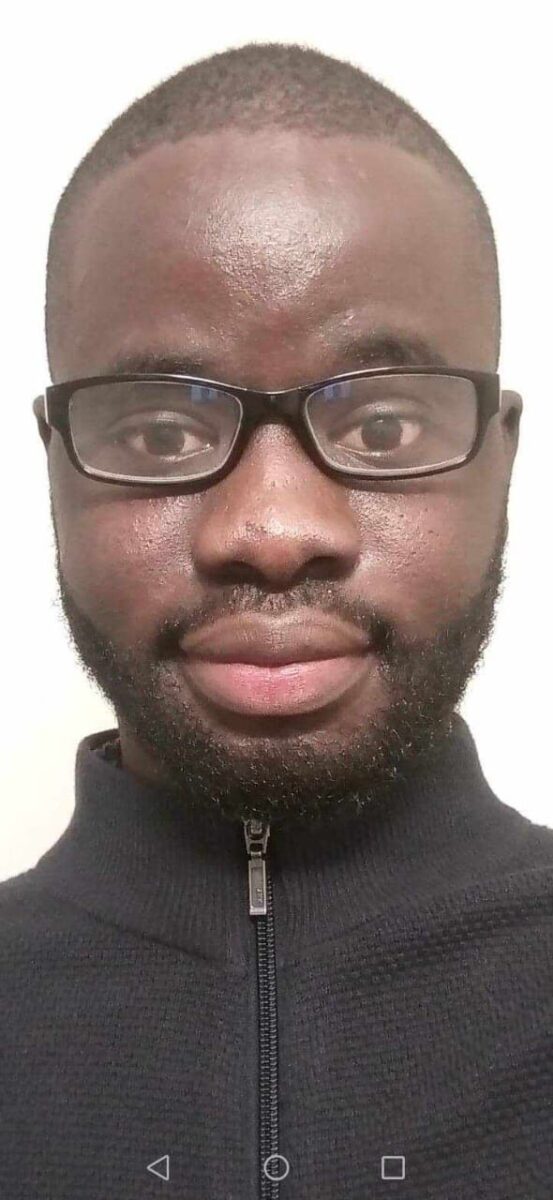Le développement fulgurant des intelligences artificielles génératives a aujourd’hui bouleversé divers domaines. La machine, qui était jusque-là sous la maîtrise plus ou moins lucide de l’homme, y gagne une place croissante, remplaçant à un rythme inquiétant l’intelligence humaine, pourtant conceptrice de cet outil révolutionnaire. Le paradoxe est évident, et l’on pourrait objecter à ceux qui sont sceptiques quant à la performance et à l’efficience de l’IA à l’école qu’il ne s’agirait nullement de repousser l’intelligence humaine au profit de l’intelligence artificielle, car cette dernière naît de la première.
En argumentation logique, il n’est pas toujours vrai que deux propositions contradictoires recèlent nécessairement l’une une vérité et l’autre une fausseté. Il est vrai que l’intelligence artificielle est conçue par l’intelligence humaine et qu’elle pourrait servir d’outil d’accès à la connaissance pour ceux qui sont éthiquement et techniquement préparés à l’utiliser. Mais il est aussi vrai de dire qu’elle peut nuire à l’homme qui l’aurait conçue. En effet, des élèves en âge d’apprentissage, non préparés à son usage progressif, seraient exposés à une forme de pollution et de perdition intellectuelle.
Il faut le dire : l’école est avant tout un cadre de socialisation, d’instruction et d’éducation où l’on forme et prépare des esprits. Ces esprits doivent par la suite évoluer par eux-mêmes dans un monde complexe, face à des problématiques existentielles insolubles pour l’IA.
Pour un bon nombre de jeunes élèves, fils d’une époque numérique, les intelligences artificielles génératives sont des moyens efficaces de résoudre des équations, tant scolaires que sociales. Cette conception de l’IA ancre en eux l’idée que la réussite scolaire ne passe plus par un travail ardu, sérieux et rigoureux. Or, travailler à l’école ou à la maison, le crayon à la main, renforce des capacités manuelles et intellectuelles essentielles à la vie, qu’on ne saurait acquérir en conversant avec ChatGPT ou DeepSeek.
En effet, l’apport de l’IA en milieu scolaire doit être pensé à l’aune de la vocation de l’école, qui est d’accompagner l’émancipation et l’autonomie intellectuelle des apprenants. Or, il n’y a pas d’élévation spirituelle lorsque l’on dispose d’un outil aussi puissant qui ne guide pas l’intelligence dans les méandres de l’inconnu à explorer, mais la propulse directement vers ce qui est censé être su. Ce savoir nécessitait auparavant, pour être découvert, un cheminement, des étapes et des préalables qui aiguisaient l’intelligence.
La capacité à débusquer une problématique, à lire longuement ligne par ligne, à analyser chaque détail d’un exercice complexe, à se fâcher parfois parce que l’on n’y arrive pas, sont autant de manières de se préparer à advenir au monde. De même, les discussions interminables entre amis, les disputes et chamailleries entre camarades, la médiation en cas de conflit, l’organisation de projets scolaires permettent le développement du sens du relationnel et préviennent l’isolement social.
Or, le jeune élève qui utilise l’IA sans avoir connu ces avantages formateurs de l’école entre potentiellement dans une phase difficile où la révélation de lui-même et de ses capacités pourrait être gravement sapée.
L’école est, en dépit de ses dysfonctionnements structurels, l’un des lieux où l’on se découvre. Sans cette découverte de soi et de son potentiel créateur, on ne peut cultiver la confiance en soi ni croire que l’on peut apporter quoi que ce soit à la société. Ce n’est pas pour rien que l’on dit que c’est à l’école que se façonne le destin d’une nation. Les énergies créatrices y germent et s’y libèrent. Il ne faut pas déposséder l’école de sa capacité à faire travailler littéralement ses pensionnaires. C’est en les éduquant au travail, à l’effort et au sacrifice qu’elle révèle le meilleur d’eux-mêmes. Si l’on étouffe cet élan sous le coup de l’impression que nous fait l’IA, nous aurons appuyé sur le bouton qui inhibe le génie sommeillant en chacun de nos élèves.
Être élève est un métier à temps plein, un métier très sérieux qui ne doit pas disparaître à cause de l’IA. Ce métier anoblit l’humain. C’est un métier sans salaire immédiat, mais dont l’intérêt est inestimable. Il consiste à consacrer le plus de temps possible au travail de l’esprit et du corps. C’est apprendre à mémoriser, à retenir, à penser, à rédiger, à jouer, à s’exercer. C’est le travail que l’on fait à tout âge et que nul ne peut nous interdire. Ce travail est un devoir et un droit universel : celui de s’éduquer, de se former, de se cultiver et de s’épanouir, aussi bien à l’école qu’en dehors.
Ce travail doit encore être permis à l’école, car il est gage de progrès humain et matériel. Il nous révèle la force de notre esprit et les talents techniques de nos mains.
Ce travail paie dans le plaisir que l’on ressent lorsque l’on arrive à résoudre une équation mathématique, lorsque l’on parvient à commenter un vers d’Elaz Ndongo Thioye en pénétrant l’imaginaire du poète, ou encore lorsque l’on se tient auprès d’un camarade de classe perdu ou triste, quelle qu’en soit la raison.
Les compétences de ce travail ne s’acquièrent que dans une école protégée de toutes les menaces d’une révolution numérique allant à contre-courant d’une civilisation à l’échelle humaine, poétique et éthique.
Mafama GUEYE, Professeur de philosophie au Lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye