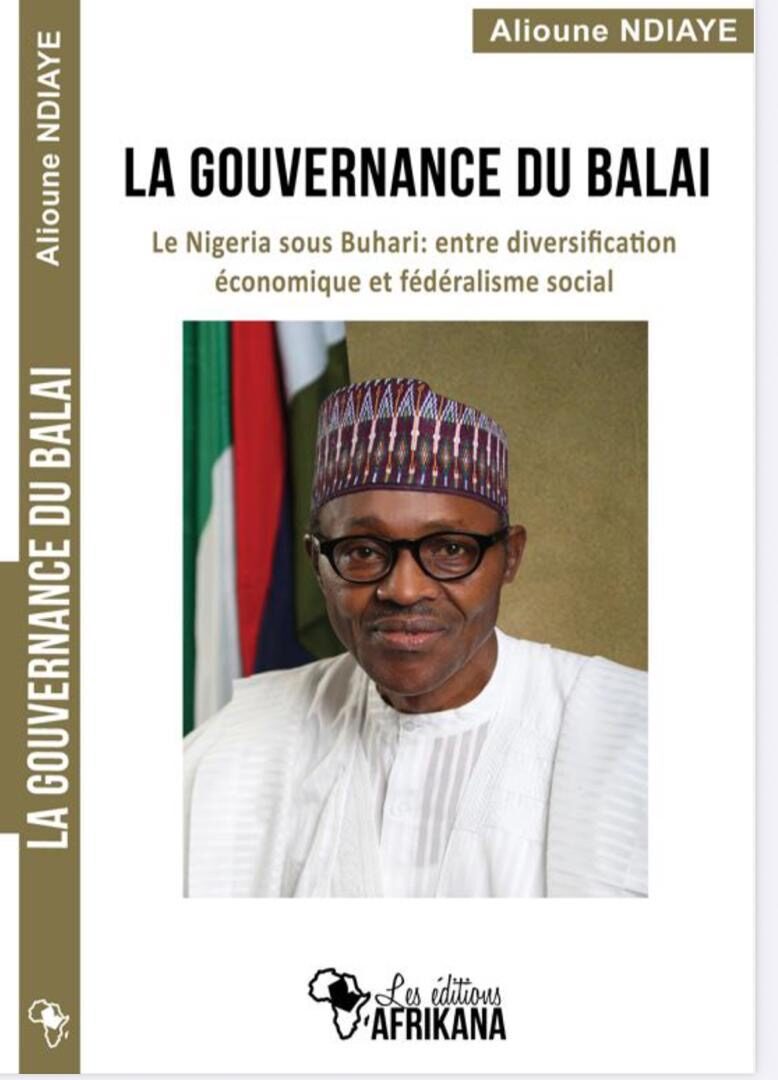Ancien enseignant-chercheur en Politique africaine et en Relations internationales à l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke,au Canada, Alioune Ndiaye est auteur du livre « La gouvernance du balai. Le Nigeria sous Buhari : entre diversification économique et fédéralisme social ». Suite au décès de l’ancien président nigérian, il revient sur son bilan au pouvoir ainsi que son héritage.
Que retenir de la présidence du président Muhammadu Buhari après ses deux mandats à la tête du Nigeria ?
De sa présidence, on peut, peut-être, reteniressentiellement qu’elle fut celle d’un leader qui a essayé d’imprimer un agenda de changement et de transformation à son pays, le Nigeria, à plusieurs échelles. Cela pourrait se résumer autour de comment défaire les vulnérabilités qui empêchaientle géant nigérian de montrer son plein potentiel. Sur le plan économique, ces vulnérabilités tournaient principalementautour d’une économie monopétrolière et qui n’a pas pu se diversifier. Le Nigeria n’avait pas pu vraiment utiliser cette rente pétrolière pour se diversifier. L’autre vulnérabilité, c’est celle d’une économie et d’un système politique plombés par la corruption. On se souvient de sa fameuse phrase quand il disait « si le Nigeria ne tue pas la corruption, la corruption tuera le Nigeria ». Durant sa présidence, Buhari a essayé de poursuivre cet agenda réformateur avec un certain nombre de défis. D’abord, le défi de la Covid-19 qui a changé tous les plans, pas juste au Nigeria,mais dans le monde, comme étant une crise ayant posé plein de difficultés sur le plan économique et social. Dans son cas, il y a eu un contexte international pas du tout favorable. Les cours du pétrole durant ses deux mandats étaient très bas. Nous pouvons imaginer l’implication que cela peut avoir pour un pays qui tire presque 3/4 de ses revenus du pétrole. De cette présidence, on peut vraiment retenir qu’il fut un homme politique qui a essayé de redresser son pays. Mais surtout, et c’est là que le cas Buhari est intéressant, il a voulu montrer comment l’honnêteté et l’intégrité peuvent être une qualité chezle leader politique au-delà des compétences classiques, particulièrementdans le contexte nigérian. L’ancien président voulait que sa présidence soit comme une sorte de témoin sur tout le potentiel que l’intégrité peut avoir dans la gestion des affaires publiques. Un de ses conseillers révélait la dernière discussion qu’il a eue avec le roi Charles. Ce dernier lui demandait s’il avait une propriété en Angleterre, comme c’est le cas de presque la majeure partie de la classe politique et économique du Nigeria. Buhari lui disait qu’il n’en a pas et que les seuls biens qu’il a, ce sont ceux qu’il avait avant d’arriver au pouvoir. Là il vient avec cette formule assez puissante où il dit « je me sens le plus libre quand je suis le plus dénué de biens matériels ».
La question sécuritaire et la lutte contre la corruption faisaient partie des promesses du candidat Buhari en 2015. Au vu de la situation sécuritaire et économique du Nigeria à la fin de son mandat, peut-on parler de réussite dans ces deux domaines ?
Le résultat est assez mitigé. Mais, si on lelit à la lumière de l’immensité des défis, on pourrait plutôt dire qu’il s’agit de réussite,même si c’est à relativiser. Sur le plan sécuritaire, au moment où Buhari arrive au pouvoir, Boko Haram était au fait de sa puissance. Et par son expérience militaire, il a pu réorganiser l’armée. L’une de ses premières décisions, c’était de remplacer tout le commandement de l’armée et de le déployer sur place, à Maiduguri, au lieu qu’il soit dans ses quartiers à Abuja. Cela, afin que ledit commandement puisse être plus proche du phénomène terroriste.Ainsi, sur le plan organisationnel et aussi de l’armement, il y a eu des succès réels.En guise d’exemple, les avions Super Tucano ont donné une réelle capacité opérationnelle et tactique à l’armée nigériane. Ces aéronefs ont, en effet,permis de prendre le dessus militairement sur Boko Haram. Parmi ses succès, il y a celle sous-régionale avec la force multinationale qui était en léthargie avant qu’il n’arrive au pouvoir. Au Cameroun et ailleurs, Muhammadu Buhari est reconnu comme étant celui qui a permis de réduire la capacité de nuisance de Boko Haram àtravers non seulement les efforts qu’il afaits sur le plan interne, mais également le fait qu’il ait contribué à raviver la coopération au niveau de la force multinationale avec les États frontaliers qui se partagent le bassin du Lac Tchad.
Toujours sur le plan économique, l’agenda de la diversification a été très bien entamé. L’un de ses héritages les plus importants, c’est de donner à l’agriculture l’importance qui était la sienne dans l’économie nigériane. Ce sont les surplus de l’agriculture qui ont permis de financer l’exploration pétrolière au Nigeria à la fin des années 50. Ce que j’appelle cette diversion du pétrole sur l’économie nigériane, Buhari a essayé de changer cela en mettant en place des initiatives très importantes dans la politique agricole,telles que l’Incore Bios programme, le Presidential Fertilizer Initiative… Toutes ces initiatives ont permis de lancer un signal à l’ensemble des acteurs économiques : le gouvernement accorde de l’importance à l’agriculture. Cela a permis des investissements très intéressants et très importants dans le domaine agricole et une augmentation de la production. Le gaz a aussi a connu cette dynamique. En effet, le Nigeria qui laissait son gaz s’évaporer ou bien brûler s’est retrouvé avec un National Gas Masterplan lancé par Buhari et qui permettait justement aussi de diversifier les revenus du côté des hydrocarbures. Ce, en essayant d’exploiter un peu plus ce gaz-là.Bref, ce qui est certain, c’est que les défis du géant nigérian demeurent, mais sous Buhari, un certain nombre de décisions ont été impulsées. La raffinerie de Dangoteaussi, qui est un élément structurel, a reçu de sa part un appui très important quand il était au pouvoir.
À votre avis, que reste-t-il de l’héritage politique du président Muhammadu Buhari ?
Son principal héritage politique reste surtout la projection d’une posture hautement morale dans la gestion des affaires publiques. Le premier mandat de Buhari, le régime militaire de 1983 à 1985, a été marqué par un fort agenda de lutte contre la corruption, la guerre contre l’indiscipline. Il est ensuite revenu dans un contexte démocratique avec, bien sûr,beaucoup plus de contraintes et moins de pouvoir que dans un régime militaire. Mais, il y a eu une continuité dans le fait de vouloir s’assurer d’un certain assainissement du système politique etéconomique nigérian à travers une forte propension à lutter contre l’indiscipline et la corruption.
Dans mon livre, je mets souvent l’accent sur cet aspect-là en disant que nous avons trop tôt voulu, dans le contexte africain,nous intéresser aux aspects institutionnels de la gouvernance. D’ailleurs, Barack Obama disait l’Afrique n’a pas besoin d’hommes forts, mais d’institutions fortes. On a voulu trop tôt, en fait trop vite, nous intéresser à l’aspect institutionnel de la gouvernance et mettre de côté l’aspect personnel. Dans le contexte africain, où il y a quand même la personnalisation du pouvoir, il peut être très contre-productif de vouloir opposer l’institutionnel au personnel. Il faut plutôt chercher une sorte de relation symbiotique qui fait que l’esprit que l’on fait courir dans les institutions, à travers la transparence, l’éthique et la bonne gouvernance, puisse être incarné par la personnalité du leader. Ce sont ces deux éléments qui, mis ensemble, peuvent absolument amener les choses en avant. Le contexte actuel au Sénégal rappelle beaucoup celui de Muhammadu Buhari. Je pense que le « Juub, Juubal, Juabanti » est un concept que Buhari pourrait absolument s’approprier s’il était traduit en haoussa ou bien en anglais puisqu’il a tout le temps était dans cette logique-là, que cela soit sous le régime militaire ou démocratique.
Entretien réalisé par Oumar NDIAYE