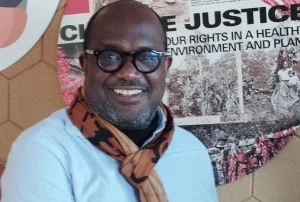À l’occasion du 90ᵉ anniversaire du Président Abdou Diouf, qui sera célébré le 7 septembre, il est utile de revenir sur la trajectoire de celui qui a présidé aux destinées du Sénégal de 1981 à 2000. Homme de rigueur, de courtoisie et d’élégance, il reste une figure majeure de notre vie politique. Mais sa gouvernance, fortement inspirée du jacobinisme français, a révélé ses limites, notamment dans la gestion de la crise en Casamance.
Cet article est adapté d’un extrait du manuscrit « Marcel Bassène, pionnier de la recherche de la paix en Casamance », rédigé à partir d’entretiens réalisés avec lui quelques mois avant sa mort le 22 août 2006. À travers ses souvenirs, c’est un portrait nuancé d’Abdou Diouf qui se dessine : un président respectueux et lucide, mais parfois prisonnier de son propre appareil d’État.
L’élégance du président et les limites du jacobinisme
Abdou Diouf incarne toujours l’image d’un homme d’État marqué par la sobriété et le calme. Sa haute silhouette, sa voix posée et son art de peser chaque mot renforçaient son autorité sans jamais sombrer dans l’emportement. Marcel Bassène insistait sur ce trait distinctif : « Il savait écouter avant de répondre. » Cette courtoisie s’étendait à tous ses interlocuteurs, qu’ils soient ministres, opposants ou notables. Là résidait une part de sa force : l’écoute, la patience et le respect des formes.
Mais cette élégance politique s’accompagnait d’un héritage intellectuel et institutionnel marqué par le jacobinisme. Formé dans les cercles administratifs de la colonisation, Diouf voyait dans l’État centralisé le garant de l’unité nationale. Ce choix assurait la stabilité du Sénégal, mais il en révélait aussi les limites. En Casamance, les décisions uniformes venues de Dakar nourrissaient un sentiment de marginalisation. Comme le rappelait Marcel, « la Casamance n’a jamais rejeté l’unité nationale, mais elle voulait être reconnue dans ses spécificités ».
Quand Diouf confia la médiation de la crise casamançaise à un député de l’opposition
C’est pourtant ce même Abdou Diouf qui, en juillet 1991, prit une décision inattendue. Par décret présidentiel du 26 juillet, il nomma officiellement Marcel Bassène, député de l’opposition (PDS), « chargé de la coordination de la paix en Casamance ». Un geste rare, à contre-courant des logiques partisanes.
Ce décret donnait à Marcel Bassène un mandat exceptionnel : entrer en contact avec toutes les parties prenantes — maquisards, notables, responsables religieux, société civile — pour ramener la paix. Le président Diouf reconnaissait ainsi qu’un médiateur enraciné dans la région, issu de l’opposition, pouvait jouer un rôle que l’appareil d’État ne savait pas assumer seul.
Entre confiance et contraintes
Dans ses échanges avec Abdou Diouf, Marcel Bassène percevait une réelle confiance personnelle. Il se souvenait de discussions franches où le président prenait des notes, posait des questions, cherchait à comprendre. Mais cette ouverture avait ses limites. Dès 1992, Marcel alertait sur le manque de financement qui paralysait sa mission. Ses initiatives se heurtaient tour à tour aux réticences du commandement militaire, aux résistances de certains cercles gouvernementaux — ironie de l’histoire, Me Wade, alors ministre d’État et secrétaire général du PDS, n’était pas le dernier à torpiller les efforts de son camarade — et aux caciques du Parti socialiste.
Cette contradiction marqua leur relation : la reconnaissance de sa légitimité par le président lui-même, mais l’hostilité persistante d’un appareil méfiant à l’égard d’un opposant.
Leçons d’une relation
Les documents d’archives confirment que cette nomination fut plus qu’un symbole : Le Président Diouf avait confié à Marcel Bassène un rôle central, qu’il assuma avec sérieux, en organisant rencontres, missions humanitaires et dialogue avec le MFDC. Mais les divisions internes du mouvement, la méfiance de certains responsables politiques et les blocages militaires limitèrent la portée de son action.
À travers ce témoignage, on voit apparaître un portrait complexe : celui d’un président d’une grande probité, soucieux de l’ordre républicain, mais prisonnier d’un modèle d’exercice du pouvoir qu’il n’a jamais remis fondamentalement en cause. Sa confiance placée en un opposant comme Marcel Bassène témoigne cependant d’une lucidité politique rare : la paix exigeait de dépasser les clivages partisans.
A lire aussi : PASTEF : l’hétérogénéité comme force stratégique de la révolution sénégalaise
À 90 ans, Abdou Diouf demeure une figure incontournable de l’histoire sénégalaise. Le regard posthume de Marcel Bassène nous en livre un portrait nuancé. Entre ouverture et contraintes, il a su reconnaître que l’unité nationale ne se décrète pas seulement depuis Dakar, mais qu’elle se construit aussi dans la reconnaissance des diversités et dans la confiance accordée à ceux qui, même dans l’opposition, servent l’intérêt du pays.
Par Félix Atchadé
Militant politique, spécialiste de santé publique et d’éthique médicale