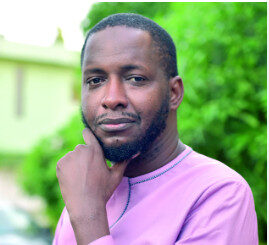À la huitième édition du Paris Peace Forum, qui se déroule entre hier, 29 octobre, et aujourd’hui, 30 octobre 2025, autour du thème « Nouvelles coalitions pour la paix, les peuples et la planète », à laquelle nous participons, l’un des chefs d’État invités est le président ghanéen John Dramani Mahama.
En novembre dernier, un autre dirigeant d’un pays d’Afrique anglophone avait été reçu avec les honneurs à l’Élysée : Bola Tinubu, du Nigeria, premier président nigérian à se rendre en France depuis l’an 2000.
L’année prochaine, le sommet Afrique–France, délocalisé pour l’occasion sur le continent, se tiendra à Nairobi, au Kenya, en mai 2026. C’est dire qu’aujourd’hui, les curseurs et marqueurs de la politique étrangère française en Afrique s’orientent davantage vers les pays anglophones que francophones. Normal et naturel, dirions-nous !
Il faut reconnaître que, malgré tout le bruit fait autour de la coopération économique entre la France et l’Afrique subsaharienne francophone, celle-ci n’a plus le même niveau qu’auparavant. De nombreux pays africains, longtemps considérés – à tort ou à raison – comme le pré carré français, ont, au cours des deux dernières décennies, diversifié leurs partenariats économiques en s’ouvrant à des pays comme la Chine, la Turquie, l’Inde ou encore la Russie. Cette tendance devrait se poursuivre.
D’ailleurs, les principaux partenaires commerciaux de Paris en Afrique subsaharienne ne sont pas le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso ou le Niger, mais plutôt l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya. L’ensemble de la zone franc CFA en Afrique de l’Ouest et du Centre ne représente qu’une part minime du commerce extérieur de la France (0,6 %).
Des deux côtés, on observe donc une diversification des partenariats économiques et une volonté de revoir les cadres de coopération.
Selon un rapport de la Direction générale du Trésor français, publié en avril 2024, les principaux partenaires de la France en Afrique subsaharienne en 2023 étaient le Nigeria (5,0 Md€), l’Afrique du Sud (3,3 Md€), la Côte d’Ivoire (2,4 Md€), l’Angola (2,0 Md€) et le Cameroun (1,5 Md€). On ne compte donc que deux pays francophones dans ce top 5.
La France est ainsi contrainte de changer de cap et d’approche, y compris dans sa politique africaine globale. Par ailleurs, les discours souverainistes et nationalistes, souvent teintés d’accents populistes, gagnent du terrain en Afrique francophone. La France perd progressivement de son influence dans ses anciennes colonies d’Afrique subsaharienne, notamment auprès d’une jeunesse traversée par une lame de fond et un sentiment anti-français de plus en plus affirmé d’où le déplacement du curseur vers l’Afrique anglophone, voire lusophone.
En visite le 17 octobre dernier au Nigeria, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui participait à la deuxième édition du Forum Création Africa, un événement consacré au développement des industries culturelles et créatives africaines, a affirmé la volonté de la France de poursuivre et renforcer la coopération avec ce géant économique et politique du continent.
Les plus grands projets du groupe français TotalEnergies sur le continent se trouvent d’ailleurs en Angola, en Ouganda ou au Mozambique, où il exploite des sites jugés prometteurs dans le domaine des énergies fossiles.
C’est dire que la perte d’influence de la France en Afrique francophone est désormais compensée par la montée en puissance de sa coopération économique et politique avec l’Afrique anglophone et même lusophone.
oumar.ndiaye@lesoleil.sn