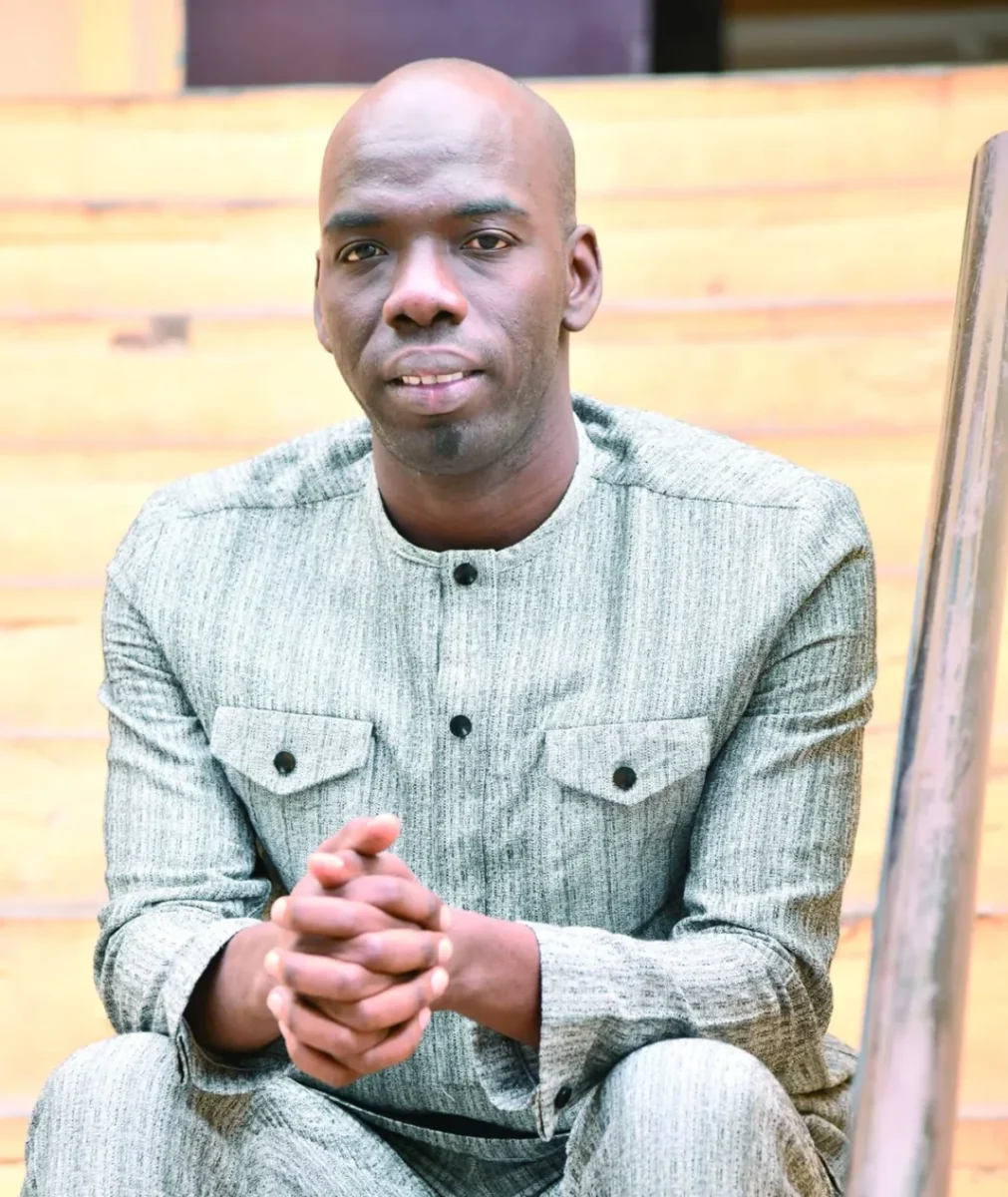Le 12 décembre 2015, la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (Cop 21) s’achevait à Paris sur un serment planétaire : contenir la hausse du mercure « en deçà de 2 °C » et « s’efforcer de la limiter à 1,5 °C » d’ici la fin du siècle. Dix ans plus tard, ce vœu pieux s’est dissous dans les vapeurs de Co2. Les pays les plus vulnérables continuent de payer les factures des excès du Nord industriel. Ouragan Melissa dans les Caraïbes, pluies diluviennes au Vietnam, canicules et incendies records en Europe : la planète brûle. L’année 2024 est devenue la plus chaude jamais enregistrée, franchissant pour la première fois la barre symbolique des +1,5 °C. Et selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), entre 2010 et 2020, la mortalité liée aux événements climatiques extrêmes a été quinze fois plus élevée dans les pays vulnérables que dans ceux mieux lotis. Quinze fois plus. C’est à Belém, au cœur de l’Amazonie brésilienne, que le monde se retrouvera du 10 au 21 novembre 2025 pour la Cop 30, après une édition sans éclat à Bakou.
Mais que reste-t-il des promesses de Paris ? Pas grand-chose, sinon une défiance croissante envers le régime climatique international. Les pays développés s’étaient engagés à mobiliser 100 milliards de dollars pour aider les nations les plus exposées à s’adapter. Dix ans plus tard, ils jurent avoir tenu parole avec le décaissement de 116 milliards de dollars en 2022. En réalité, selon Oxfam, la valeur réelle des dons ne dépasse pas 35 milliards, soit à peine un tiers de la somme annoncée. Le reste ? Des prêts, souvent à taux commerciaux, alourdissant un peu plus la dette des plus pauvres. Les Pays les moins avancés (Pma) n’ont reçu que 19,5 % de ce financement. Les agendas du Nord et du Sud n’ont jamais été aussi éloignés. D’un côté, les grandes puissances continuent d’extraire, de forer et de brûler sous couvert de transition énergétique. De l’autre, elles sermonnent le Sud en lui promettant des milliards qui ne viendront jamais. On exige des pays africains qu’ils exploitent leurs ressources sous le label de la « gouvernance durable » pendant que les industries fossiles du Nord tournent à plein régime. Le climat, lui, ne négocie pas. Il avance sans état d’âme. Et l’Afrique, qui ne représente que 4 % des émissions mondiales, en subit 100 % des conséquences : sécheresses, inondations, insécurité alimentaire, migrations forcées…
Le constat est implacable : le continent le moins pollueur est celui qui souffre le plus. L’erreur du Sud, c’est d’attendre la justice climatique comme on attend la pluie : les yeux vers le ciel, les mains tendues. À chaque Cop, les mêmes promesses, les mêmes communiqués, les mêmes désillusions… Pendant ce temps, nos pays continuent de monter des projets environnementaux taillés sur mesure pour les bailleurs du Nord en espérant des financements qui se perdent dans les limbes de la diplomatie. Il est temps de créer nos propres mécanismes de financement domestique, de miser sur des taxes carbone locales, sur des fonds verts régionaux et sur des politiques agricoles et énergétiques souveraines. Parce qu’à force d’attendre le Nord, nous risquons de geler dans l’ombre de son cynisme. Et une chose est désormais certaine : la justice climatique ne viendra pas du Nord.
bgdiop@lesoleil.sn