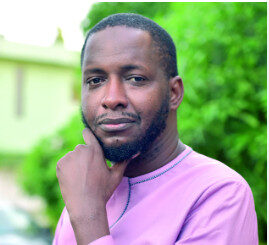C’est en novembre 2019, dans une interview avec l’hebdomadaire anglais « The Economist », que le président français Emmanuel Macron diagnostiquait l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (Otan) d’une « mort cérébrale ». Un bulletin de santé qui est très loin du dynamisme que connaît actuellement cette Alliance militaire qui, avec ses 32 États membres, est la plus grande au monde. Pourtant, plusieurs pays, comme la Pologne, la Finlande ou le Danemark, dénoncent des incursions probables de l’aviation russe, notamment par des aéronefs et des drones, qui violeraient leur espace aérien.
Mise sous sédatif depuis plusieurs années, surtout lors du premier mandat du président américain (2016-2020), l’Alliance atlantique est en train de ressusciter avec le retour de la guerre de haute intensité et d’une grande hybridité en Europe. Le conflit russo-ukrainien a ainsi convaincu le camp occidental, berceau normal de cette Alliance militaire, que face aux menaces pressantes et prégnantes surtout venant de la Russie, la meilleure réponse est de faire face, en bloc.
C’est ainsi que, pour son retour triomphal dans le giron de l’Otan pour son deuxième mandat, le président américain a ainsi obtenu ce qu’il réclamait depuis toujours : que l’Amérique, leader naturel de cette coalition, revienne sur le bord avec une thérapie de choc. Lors de la dernière réunion de l’Otan qui s’est tenue en juin dernier à la Haye, aux Pays-Bas, le relèvement des dépenses militaires et sécuritaires à hauteur de 5 % du Pib pour chaque État membre, une exigence américaine, a été acté. « Vous n’avez aucune coordination de la décision stratégique des États-Unis avec les partenaires de l’Otan et nous assistons à une agression menée par un autre partenaire de l’Otan, la Turquie, dans une zone où nos intérêts sont en jeu, sans coordination », avait ainsi déclaré Emmanuel Macron en novembre 2019.
Cette absence de coordination et de réaction dont il se plaignait semble aujourd’hui s’effacer, pour faire place à une prise de conscience de plus en plus vivace et tenace que la menace soviétique qui, en 1949, au début de la guerre froide, avait prévalu à la création de l’Alliance atlantique, a juste changé de dénomination et de champ d’action. Avec ses intentions de faire retrouver la Russie sa grandeur et splendeur d’antan, le président russe Vladimir Poutine a ainsi réactivé une vieille relique de la politique étrangère de son pays qui est la doctrine de la « souveraineté limitée ou l’étranger proche ». C’est-à-dire, chaque fois que dans un pays de l’Est, le capitalisme menace le socialisme, l’Urss a l’obligation d’intervenir militairement. Les attaques russes contre l’Ukraine, de même que les incursions -même si elles ne sont pas jusqu’ici assumées-, sur les pays limitrophes comme la Pologne ou les pays scandinaves, Finlande, Danemark, sont ainsi à mettre dans cette optique. Forcément, cela va engendrer une réaction et surtout une réactivation de l’article 4 du Traité Atlantique qui dispose clairement que : « Les parties se consulteront chaque fois que, de l’avis de l’une d’elles, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique ou la sécurité de l’une des parties sera menacée ».
« Les parties conviennent qu’une attaque armée contre l’une ou plusieurs d’entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence, elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d’elles, dans l’exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l’article 51 de la Charte des Nations unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées (…) », dixit l’article 5. Il est donc à craindre que ce retour triomphal et magistral de l’Otan soit celui aussi de l’antagonisme Est-Ouest où chacune des parties affûte ses armes et ses alliances pour se faire face… oumar.ndiaye@lesoleil.sn