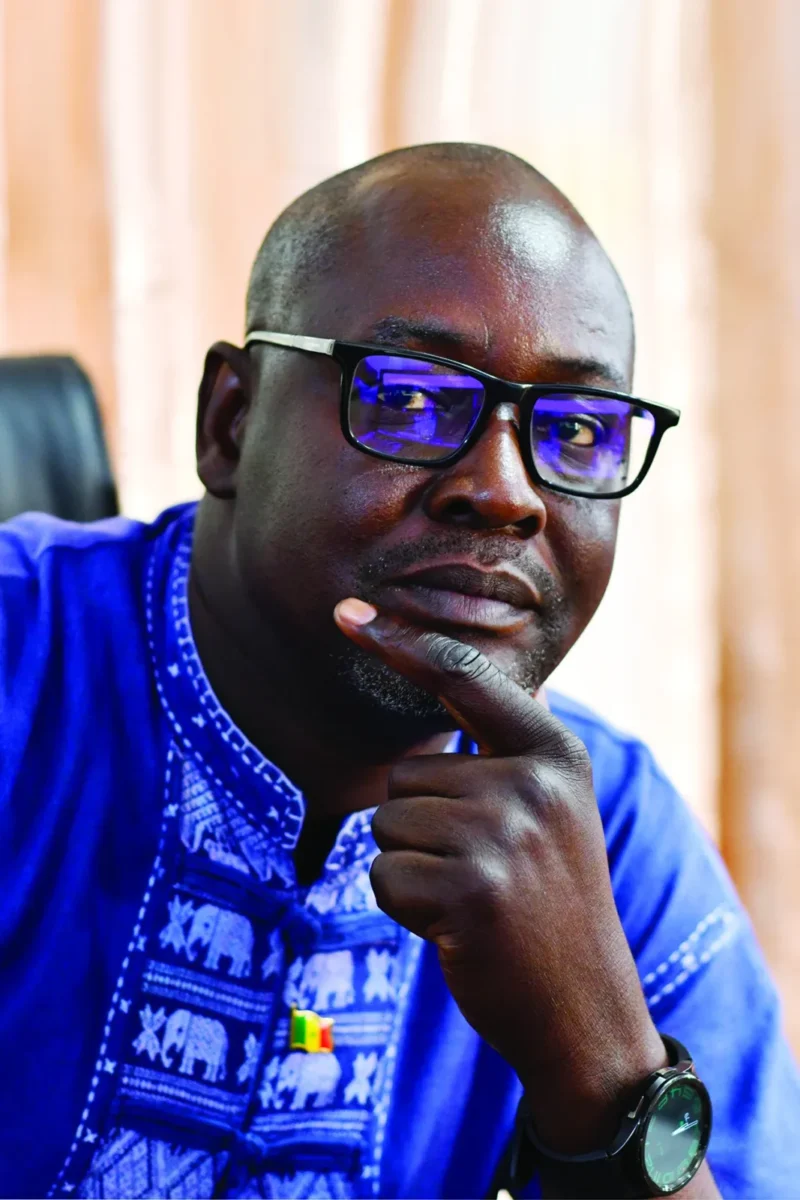C’est une scène inédite, voire irréaliste, qui s’est passée à Mexico, la capitale fédérale du Mexique. C’était le 4 novembre dernier. La présidente du pays, Claudia Sheinbaum, prenait part à une manifestation publique, non loin du palais présidentiel : le Palacio Nacional. Un homme, visiblement ivre, s’est approché d’elle, lui a passé un bras autour de l’épaule et a tenté de l’embrasser au cou tout en la touchant à la poitrine et à la hanche. Immédiatement maîtrisé, l’individu a été arrêté quelques heures plus tard. Devant les caméras, celle qui dirige ce pays de l’Amérique latine de plus de 132 millions d’habitants est victime d’une agression sexuelle en pleine rue à Mexico.
Claudia Sheinbaum, première femme à occuper la présidence du Mexique, a décidé de porter plainte pour harcèlement sexuel, affirmant qu’il ne s’agit pas d’un acte isolé. « Si cela arrive à la Présidente, que va-t-il advenir de toutes les autres femmes ? », soutient-elle. Par cette plainte, Sheinbaum ne revendique pas seulement justice pour elle-même, elle entend donner une voix aux milliers de Mexicaines confrontées quotidiennement à des formes de violence sexuelle.
Cette effronterie est favorisée par les bains de foule dont la Présidente raffole. Pour certains sociologues comme Sigmund Freud et Gustave Le Bon, la foule n’est pas uniquement la somme des individualités. C’est une entité autonome unique répondant aux instincts et aux passions les plus ordinaires. Au sein de la foule, arguent-ils, les émotions prennent le pas sur la morale et on a tendance à développer des mécanismes de défense souvent régressifs, primitifs.
En 2024, l’examen d’un projet de loi des finances au Kenya a permis de développer chez les internautes de ce pays d’Afrique orientale une forme de contestation pacifique, mais puissante. Une arme numérique redoutable qui permet de spammer, en une fraction de seconde, les boîtes mail et autres outils de communication numériques des autorités. En effet, face au projet de loi controversé, de nombreux manifestants ont diffusé les mails, numéros de téléphone, WhatsApp et autres réseaux sociaux de députés et ministres, incitant les populations à les inonder de messages. Ainsi, des milliers de Kenyans ont assailli les responsables politiques avec des textos et des messages pour exprimer leur colère contre les impôts. Le tollé a été si important que l’Office du Commissaire à la Protection des Données du pays a dû publiquement appeler à cesser ces envois massifs. Au-delà de la protestation numérique, la conviction des internautes kenyans, c’est qu’en inondant les canaux officiels, ils peuvent contraindre les décideurs à faire entendre leur voix.
En juin 2021, en visite dans la Drôme pour rencontrer restaurateurs et étudiants après la crise sanitaire de la Covid-19, le président français Emmanuel Macron s’approche d’un petit groupe venu le saluer. À peine tend-il la main qu’un individu lui assène une gifle tout en criant « Montjoie ! Saint-Denis ! » Un slogan associé à la mouvance royaliste. Aussitôt maîtrisé par le service de sécurité, l’homme est placé en garde à vue. L’agression, filmée et largement relayée, provoque un choc politique et une condamnation unanime. Jugé en flagrant délit, l’auteur est condamné à 18 mois de prison, dont 14 avec sursis, assortis d’une interdiction d’exercer des fonctions publiques et d’une obligation de soins. En effet, si dans certains pays les injures à l’endroit des autorités sont qualifiées de crimes de lèse-majesté, dans d’autres, la montée des violences à l’égard des élus, voire des détenteurs de pouvoirs publics, inquiète. Malheureusement, la combinaison de la polarisation politique, de la désinformation en ligne et du rejet croissant des institutions alimente un climat où la violence contre les représentants publics tend à se banaliser, fragilisant la vie démocratique. Au Sénégal, on n’est pas trop loin de ce scénario. Il suffit juste de jeter un coup d’œil sur le mur Facebook de la présidence de la République pour s’en rendre compte.
aly.diouf@lesoleil.sn