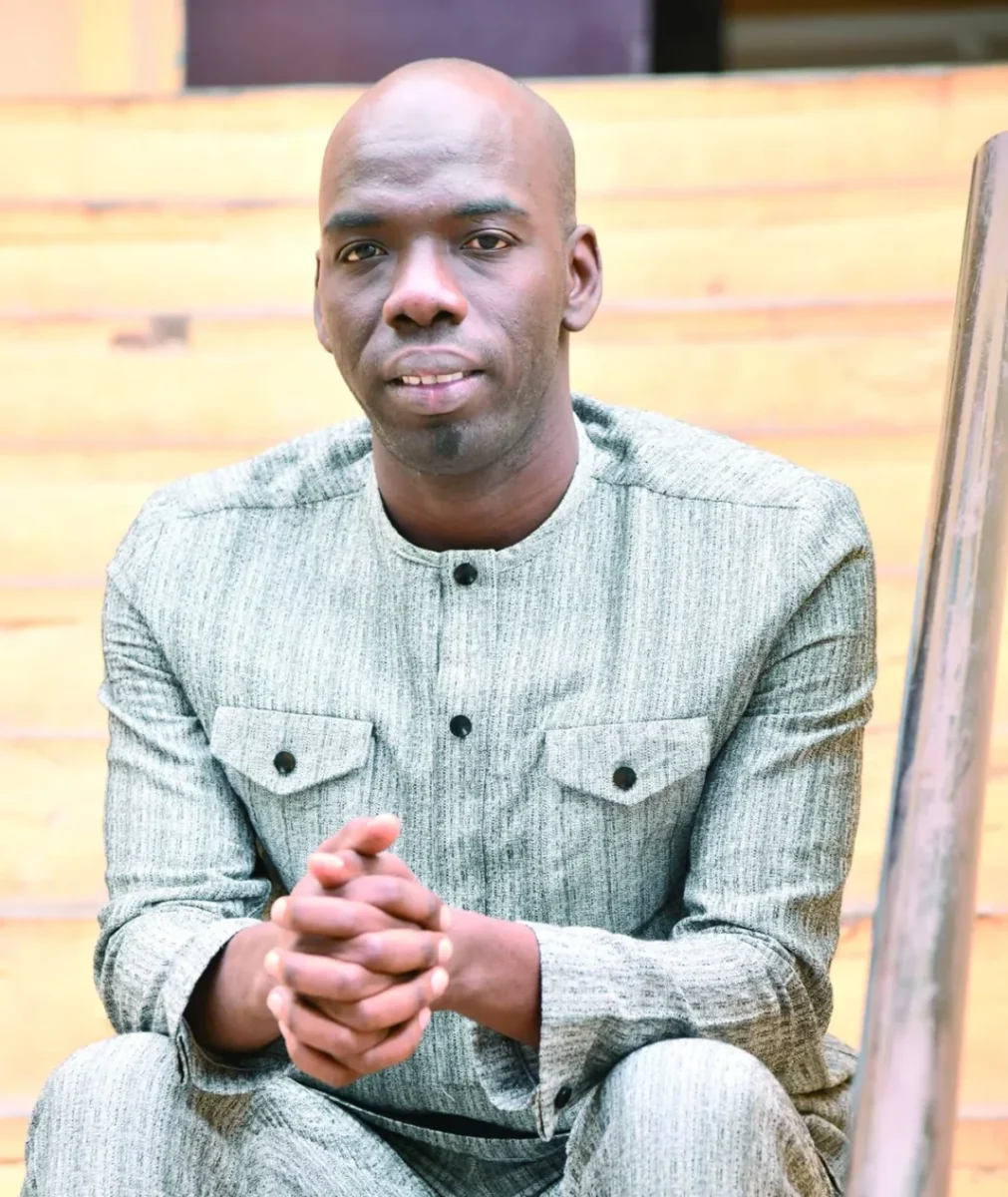Chaque année, les Cop ressemblent à une grande chorégraphie : les pays riches mènent la danse et les pays pauvres suivent le rythme. Et pourtant, le sol sous nos pieds brûle. De Paris à Glasgow, du Caire à Baku en passant par Dubaï et aujourd’hui Belém, la musique reste la même : des promesses grandiloquentes, des engagements flous qui se greffent à des lendemains sans effet. En effet, comme la planète se réchauffe en raison du changement climatique, les zones gelées diminuent. Selon l’Onu, des milliards de personnes risquent, dans les années à venir, de faire face à des inondations, sécheresses, glissements de terrain et élévation du niveau de la mer.
Pendant ce temps, les dirigeants débattent de virgules dans des accords interminables. Silence, la planète s’embrase. Les glaciers fondent, les forêts s’éteignent et les océans montent. Dans les salles climatisées, on parle de « neutralité carbone», de «transition juste», de «solidarité internationale». Mais sur le terrain, le dérèglement climatique frappe sans pause ni diplomatie. Les Conférences des parties sont devenues le symbole de l’hypocrisie collective. Elles réunissent gouvernements, multinationales, Ong et militants. Tous prétendent vouloir sauver la planète, mais aucun ne veut en payer le prix. Les pays du Nord promettent des milliards pour soutenir le Sud mais ces fonds se font attendre ou se transforment en prêts qui aggravent la dette.
Dans le même temps, les industries fossiles reçoivent encore plus de 7.000 milliards de dollars de subventions chaque année, selon le Fmi dans un rapport de 2022. Comment parler de transition énergétique quand les pollueurs sont les mécènes des Cop ? Comment évoquer la solidarité climatique quand les pays africains, responsables de moins de 4 % des émissions mondiales, subissent sécheresses, inondations et pertes agricoles ? Depuis l’Accord de Paris en 2015, la température mondiale a déjà augmenté de 1,3 °C. Chaque dixième de degré supplémentaire emporte son lot de drames humains. Toutefois, les négociateurs s’enlisent dans des débats sémantiques : faut-il « sortir » ou simplement « réduire » les énergies fossiles ? Faut-il « compenser » ou « transformer » ?
À Belém, on discute encore de « pertes et dommages » ou de « mécanismes innovants de financement ». Derrière ces mots technocratiques, un aveu d’impuissance : les dirigeants temporisent pendant que les peuples souffrent. Au Mozambique, au Niger ou à Saint-Louis du Sénégal, la catastrophe n’est plus un scénario mais une réalité vécue. La crise climatique est une question de responsabilité historique. Ce sont les pays industrialisés qui ont saturé l’atmosphère en carbone. Aujourd’hui, ils prêchent la sobriété aux autres tout en défendant leur confort énergétique. Le Sud ne demande pas la charité mais la justice. Il ne réclame pas des promesses, mais des réparations. Car demander réparation, ce n’est pas tendre la main. Il s’agit plutôt de réclamer un dû. La justice climatique impose que ceux qui ont profité du désastre en paient le coût. Elle exige aussi que les nations vulnérables puissent s’adapter sans s’endetter davantage.
Depuis trente ans, les Cop produisent des textes et des résolutions mais il y a peu de changements concrets. Le langage diplomatique ne refroidit pas la planète. Mais les puissants, eux, continuent de danser au rythme lent des intérêts économiques et des calculs politiques. La COP30 à Belém est le placé sous le signe du sursaut. Souhaitons qu’elle ne soit celle des illusions. Une de plus. En définitive, il est encore temps de changer la musique pour passer du bal diplomatique à la marche résolue vers une planète vivable.
bgdiop@lesoleil.sn