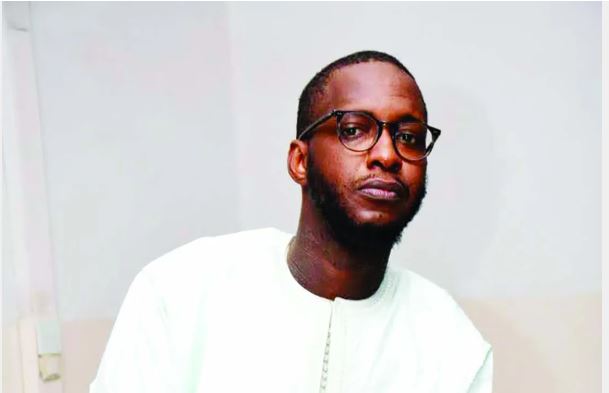Le déplacement du pivot américain vers l’Asie du Sud et le Pacifique était motivé par ce que l’ancien Secrétaire d’État adjoint Kurt Michael Campbell appelait « l’arc of ascendance » (arc de l’ascension ou de la croissance), désignant cette zone géographique portée par une dynamique de puissance et un poids croissant dans le commerce mondial.
Jusqu’alors, la présence américaine était centrée sur le Moyen-Orient, où les États-Unis s’appuyaient sur leurs alliés arabes historiques, dans une région que Campbell qualifiait d’« arc of instability » (arc de l’instabilité), en raison des tensions persistantes, notamment entre Israël et les pays arabes. La récente tournée du président américain Donald Trump, achevée vendredi, montre que les États-Unis ne sont pas prêts d’abandonner cette région au profit de l’Extrême-Orient. Les quatre jours passés en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis – que Trump a qualifiés de « fantastiques » – illustrent sa diplomatie transactionnelle, qui pourrait renforcer le poids géopolitique du Moyen-Orient dans la nouvelle politique étrangère américaine.
Cette posture vise à contrebalancer l’attention portée à l’Asie du Sud-Est et au Pacifique, devenus les principaux axes de la diplomatie américaine depuis 2008. L’homme d’affaires devenu président s’est montré enthousiaste au terme de cette tournée, en annonçant quelque 4.000 milliards de dollars de promesses de contrats dans les trois pays visités. Porté par d’abondantes ressources pétrolières et gazières, le Moyen-Orient reste l’un des centres névralgiques de la production mondiale d’énergies fossiles. Cette rente constitue depuis près d’un demi-siècle la principale source de revenus de ces pays. En 2010, le pétrole extrait du Moyen-Orient représentait 31 % de la production mondiale, en faisant de loin la première région productrice au monde. Avec l’arrivée au pouvoir de jeunes dirigeants dans plusieurs monarchies du Golfe, souvent connectés et désireux de s’affranchir d’un certain dogmatisme socio-religieux, cette zone évolue vers davantage de modernité. La diversification économique est désormais une priorité en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis, qui ne comptent plus uniquement sur la rente pétrolière et gazière.
Depuis plusieurs années, ces États investissent massivement dans des secteurs à forte valeur ajoutée : hôtellerie de luxe, technologies vertes, énergies renouvelables comme le solaire ou l’hydrogène. Des pays comme l’Arabie Saoudite ou les Émirats se positionnent désormais sur les grands enjeux du siècle, à commencer par la transition énergétique. Hôte de la Cop28 en 2023, Dubaï – plus grand émirat du pays – s’inscrit dans une dynamique de neutralité carbone, en engageant une sortie progressive des énergies fossiles. L’Arabie Saoudite, quant à elle, a lancé un ambitieux plan de développement intitulé Vision 2030, porté par le prince héritier Mohammed Ben Salmane.
Ce projet vise à faire du royaume une nouvelle destination du tourisme mondial et un pôle d’innovation en matière d’énergies propres. Cette nouvelle orientation ouvre pour la région des perspectives de croissance durable, rompant avec les cycles de crises et de conflits armés. Le Moyen-Orient, longtemps perçu comme un foyer d’instabilité, pourrait bien se réinventer en terre d’opportunités économiques et de transformation stratégique.. oumar.ndiaye@lesoleil.sn