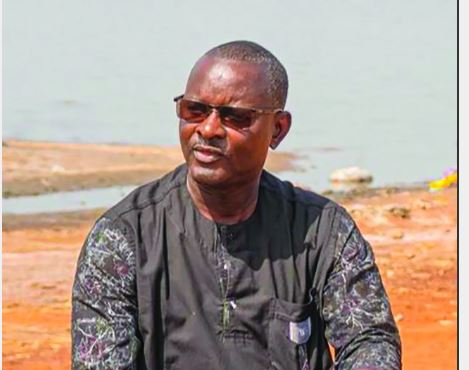Je m’en allais sur le Boulevard du Centenaire une après-midi de samedi comme tous les Sénégalais qui, avec épouse et enfant, s’échinent à mettre de l’ordre sur une question domestique. Oh, rien de très préoccupant ! Juste l’exercice de la calculette que maîtrisent du reste tous les assujettis aux rigueurs de la vie.
Ce n’est pas une affaire de zéros alignés comme pour le gros lot au jeu de hasard. C’est une affaire de chiffres trop justes pour couvrir le corps ample des besoins. Je me suis donc arrêté devant un guichet automatique de banque et j’ai pris quelques pauvres billets. Juste après, j’ai vu une foule débouler de la Médina, traverser le parcours du Brt et se diriger vers le rond-point de la Rts. Je n’ai dû mon salut qu’à un coup d’accélérateur, un jeune déchaîné tentant d’ouvrir ma portière, un autre devant, l’air menaçant. C’était un jour de combat. Une scène effarante en temps normal, devenue ordinaire sous le règne de la terreur elle-même ordinaire.
C’était jour de combat de lutte. Le même jour, de l’entrée de Pikine par le Technopôle à la Route des Niayes de Pikine, les malfrats ont imposé leur loi. Voilà, c’était jour de combat, jour de résignation. C’était tout ! Autour de l’Arène nationale, les jours de combat sont des jours de peur. Les agressions commencent parfois dans la matinée dans le périmètre du Technopôle. En d’autres occasions, le déluge de violence s’étend aux fiefs des lutteurs. Cela peut être Diamaguène, Médina, Hann, Thiaroye, Yeumbeul, Guédiawaye, etc. Ça pétarade, les coupe-coupe virevoltent et les paisibles gens sont dépouillés. Chaque mort et chaque blessé sont les témoignages désespérés sur cette furie. Le sport n’est pas en procès dans son Adn.
C’est l’environnement du sport qui dérange. Les nostalgiques évoquent les civilités d’époque. Les amateurs de deux bords se retrouvaient autour d’un déjeuner puis, endimanchés, se rendaient au stade. Les lutteurs savaient chanter et danser. Ils savaient chambrer après une victoire sans bavure en mimant le geste de la photo qui immortalise leur succès. Rappelez-vous Pape Kane et Double Less… Tout ça était en fin de compte sympathique comme l’étaient les « Navétanes » rythmés par des joutes sportives et culturelles pourtant sans merci. Cependant, une Asc n’hésitait pas à rendre visite à une autre pour sa séance culturelle de la nuit.
C’était l’époque où les gens avaient la naïveté de croire en la bienveillance et en la fraternité dans l’adversité. Ce n’était pas le temps de la Tv ou des réseaux sociaux. C’était l’époque où les supporters placardaient les pages du quotidien « Le Soleil » sur leurs murs lorsque celui-ci parlait de l’équipe de leur quartier. L’époque où les quolibets, savamment lancés, n’avaient pas cédé le bitume à la pierre et au sang. En lieu et place de l’eau de pluie, tombent maintenant des larmes. Ciel, on dirait que le temps a rendu les esprits horribles ! Le cycle des pluies revient, mais l’esprit « Navétanes » est plongé dans un long cycle de sécheresse morale.
C’est le crépuscule d’une tranquillité. Comme une terre en larmes sous la menace des armes blanches, l’on se barricade. Le supplice est long alors que les compétitions, jadis, furent intenses et circonscrites dans un trimestre. Une saison des pluies dure maintenant douze mois ! Non pas parce qu’elle est longue comme un jour sans pain, mais bien parce notre quiétude est à la peine face au déluge de violence. Voilà les « Navétanes », compétition populaire qui fait tout ce que doit faire une compétition pour être impopulaire.
C’est l’indiscipline triomphante lorsque ces deux disciplines dites majeures sont en démonstration, à savoir le football populaire et la lutte. Ces compétitions « bien de chez nous » créent un règne de la terreur chez nous. « Navétanes » et combats de lutte mettent véritablement notre quiétude sur quatre appuis, sans que les arbitres osent prononcer le verdict. À ce sujet, la mesure de retrait des forces de l’ordre de l’organisation des combats de lutte est un sujet d’une grande préoccupation. Ne feignons pas l’étonnement ! Tout le monde a vu venir cette bourrasque intraitable sur l’arène et les « Navétanes ».
Je comprends : lorsqu’on perd son âme, on ne se voit pas physiquement transmuer ; on pense rester le même sans être le même parce qu’on s’est déjà vidé de son âme. L’ange d’hier devient le monstre d’aujourd’hui et, pire, le facteur qui pervertit notre futur en compromettant la santé mentale de nos enfants et la vie d’honnêtes gens. Bas les masques ! Y en a marre des escadrons de la mort qui peuplent les rues à chaque fois qu’il y a match ou combat de lutte. L’argent et la politique se sont invités dans des joutes de proximité, alimentant l’impunité d’âmes impénétrables pour les vertus de politesse et d’empathie.
Cela nous vaut un déluge de violence en hivernage et bien au-delà. Le mal croît à tel point qu’on se demande : « il est interdit d’interdire » ? Ce slogan de mai 1968, présenté à l’origine comme une boutade de l’humoriste Jean Yann, s’adapte à notre désarroi de 2025. Le silence des témoins est pire que l’audace des bourreaux. Il faut bien déchirer la peur collective de nommer une faillite de l’environnement du sport pour rendre au sport la beauté de l’olympisme. Un « Baawnaan » éthique.