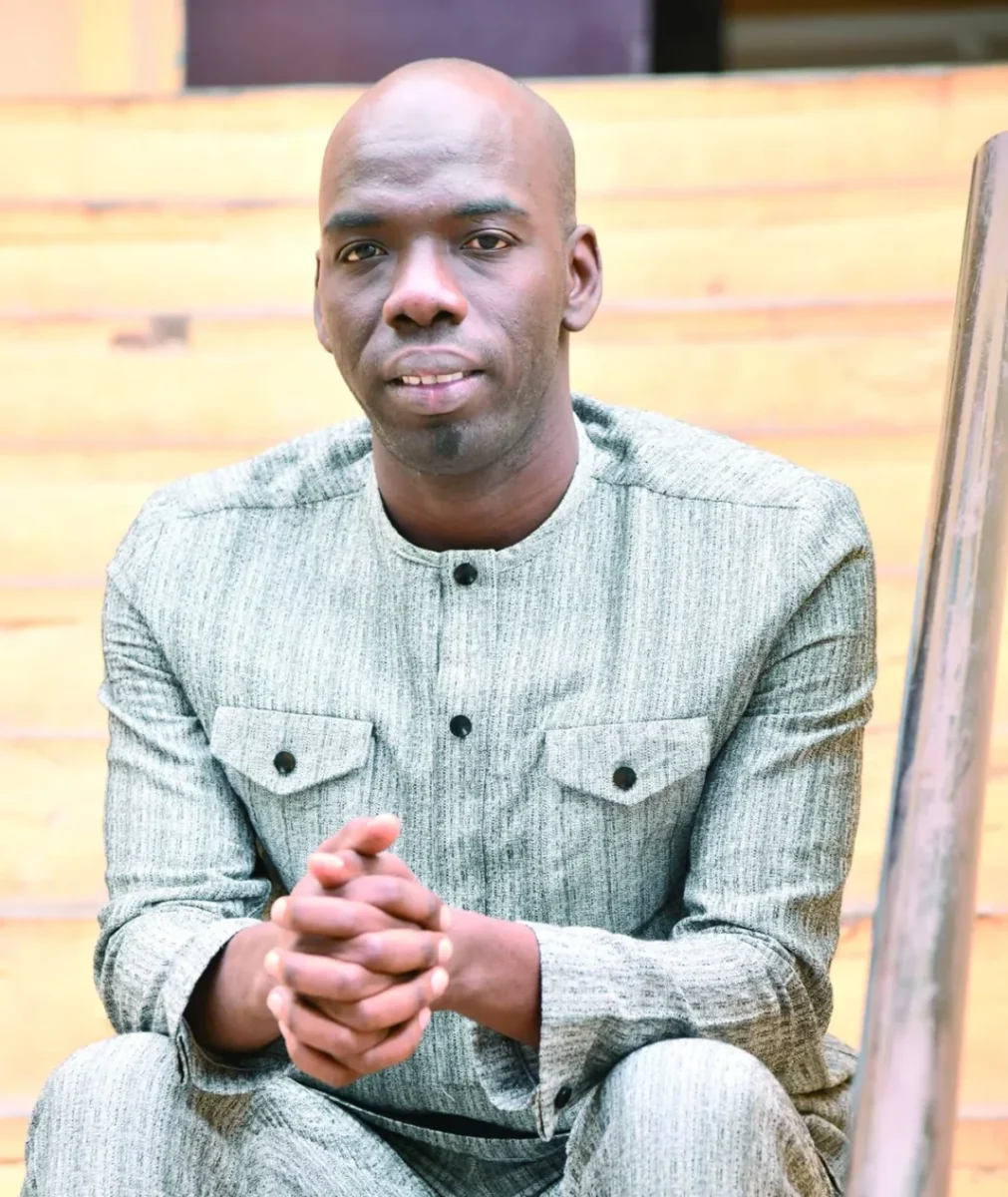À Dakar, le béton grignote la terre. Dans une capitale qui suffoque sous la chaleur, les ilots de fraicheurs se font discrets. L’arbre, lui, ne demande rien : ni électricité ni subvention. Pourtant, il donne tout : abri, oxygène, beauté, silence. Il est à la fois mémoire et promesse. Alors que la Journée nationale de l’arbre sera célébrée ce 3 août 2025, planter n’est plus un geste anodin, c’est un acte de résistance écologique, un choix politique, un engagement moral. Car promouvoir l’arbre, ce n’est pas seulement reverdir nos rues, c’est réhabiliter notre rapport au vivant, redonner au sol sa dignité et aux citadins un souffle d’espoir. Dimanche prochain, autorités, acteurs de la société civile, mouvements associatifs, citoyens… tous, dans un élan unitaire, vont vanter les vertus de reboiser, les avantages de protéger la végétation pour la biodiversité, un cadre de vie agréable… Mais ce sera malheureusement une routine. Chaque année, on plante, on formule de pieux vœux et l’année suivante, on recommence.
Pendant ce temps, entre 2005 et 2023, les pertes occasionnées par la déforestation au Sénégal sont estimées à 339.673 hectares, soit une perte annuelle moyenne estimée à 17.034 hectares, selon le ministère de l’Environnement et de la Transition écologique. Face à une urbanisation galopante, la nature subit les assauts des chantiers de maisons et des infrastructures d’utilité publique. Ainsi, le Sénégal est passé d’un taux d’urbanisation de 23 % en 1960 à 45,2 % en 2013, puis à 47,8 % en 2023, d’après une étude publiée en juin 2025 par la Direction de la prévention et de la gestion des inondations (Dpgi). De ce fait, sur le plan écologique, la disparition progressive des zones humides et la fragmentation des espaces naturels contribuent à la dégradation de la biodiversité et à une hausse des températures locales.
La fragilité des infrastructures, combinée à l’irrégularité croissante des précipitations, renforce les vulnérabilités face aux impacts du changement climatique. Aujourd’hui, près de la moitié de la population vit en zone urbaine, dans un contexte de forte pression démographique. À Guédiawaye, la bande des filaos avait pour mission de réguler la température pour limiter les effets de l’embrun marin. C’était aussi un outil de protection des maraîchers qui s’activaient dans les cuvettes. Ces filaos permettaient également de fixer les dunes de sable. Malheureusement, la coupe abusive des arbres a compromis tout cela. D’ailleurs, des experts prédisent un ensablement des maisons dans quelques années à cause de la disparition des filaos. La forêt classée de Mbao, elle, est agressée de jour en jour. L’heure est venue de réconcilier Dakar avec sa végétation. De plus, il faut se départir de cette vision de voir l’arbre comme un obstacle aux projets urbains, mais comme un pilier de notre résilience collective.
Dans les écoles, les places publiques, les quartiers populaires comme les zones huppées, chaque arbre compte, chaque racine est un ancrage. Lors du Conseil des ministres du 16 juillet 2025, le Chef de l’État avait rappelé au gouvernement l’impératif d’assurer sur l’étendue du territoire national la protection et la préservation de nos massifs forestiers. Il a demandé au ministre de l’Environnement et de la Transition écologique de « poursuivre et d’intensifier, avec les acteurs institutionnels, les opérateurs privés et les populations concernées, les efforts de reboisement et de gestion durable des massifs forestiers par l’accélération des mécanismes d’aménagement et de classement de forêts ». Et si demain, au lieu d’une forêt de poteaux d’antennes, Dakar se rêvait ville-jardin ? Le pari est audacieux. Donc, plantons. Protégeons. Pour que Dakar respire. bgdiop@lesoleil.sn