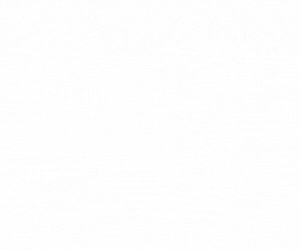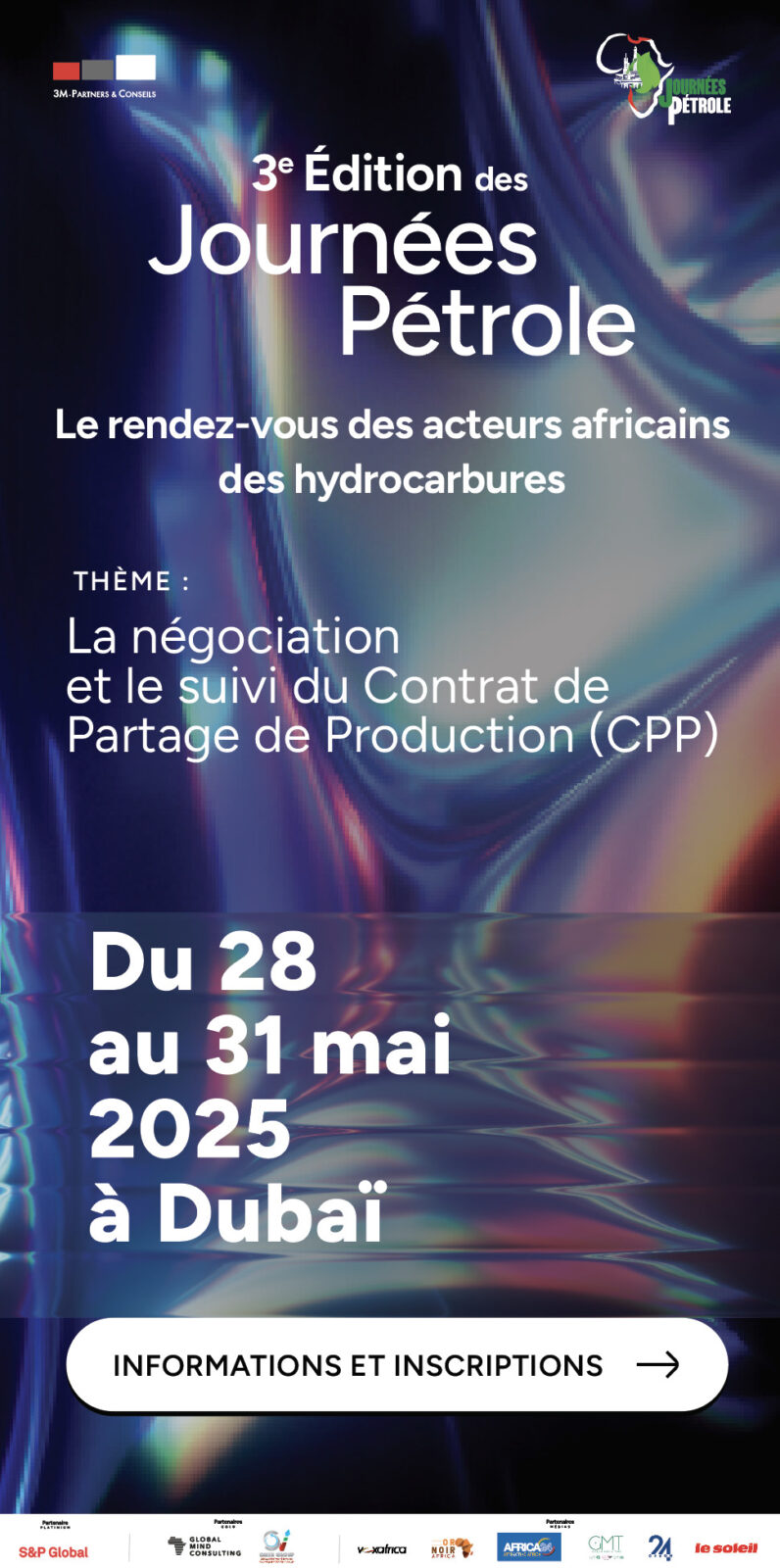Première dizaine de mai. Le voyage du prédicateur suisse d’origine égyptienne Tariq Ramadan au Sénégal pour les besoins d’un colloque universitaire organisée par le Pr Moustapha Ly a été meublé par des visites privées fort à propos et une plongée dans divers lieux symboliques du mouridisme : Résidence Khadimou Rassoul où il a été reçu par le Khalife général Serigne Mountakha Mbacké ; « Daraay Kamiil », la grande bibliothèque inaugurée en 1977 ; Mbacké Kajoor, dans le département de Kébémer, là où est née la voie fondée par le serviteur du Prophète (Psl). À Dakar, Tariq Ramadan a animé une conférence à l’espace « Maam Samba » sur le thème autour du « Khidma », ainsi qu’on nomme en études islamiques l’idée de service, qu’il soit juridique, spirituel ou social.
Son exploration se décline dans diverses disciplines. En Fiqh (interprétation temporelle de la Charia) par exemple, c’est le « service » envers l’autorité légitime, les droits et devoirs du serviteur. L’ouvrage d’Abdou Aziz Mbacké « Majalis », « Khidma, la vision politique de Cheikh Ahmadou Bamba : essai sur les relations entre les mourides et le pouvoir politique au Sénégal », paru en 2010, est une référence à ce sujet. Le lointain Paul Marty, historien de l’Islam au Sénégal, l’évoque aussi dans son ouvrage-culte (jusqu’au renouveau des études africaines), « Études sur l’Islam au Sénégal. Tome II : Les Doctrines et les Institutions », paru en 1917, et dans lequel il analyse les structures et obligations religieuses dans le Sénégal d’alors, où le « Kitāb al-Khidma » est examiné dans le cadre du Fiqh et des relations maître-serviteur dans un contexte confrérique.
Tous ces auteurs rapportent également que la « Khidma » est perceptible chez ceux qui sont dédiés à la science du hâdith, et globalement, dans la tradition soufie. Et dans un contexte contemporain, le « Khidma » s’attache par extrapolation à l’engagement associatif, aux curricula universitaires. L’Islam se déploie en permanence sur les champs de la pensée après le respect du dogme, contrairement aux corsets entretenus ailleurs. Le concept de « Khidma » est maintenant brillamment repris en charge par des intellectuels mourides qui sont allés plus loin dans la définition. Ainsi, le Pr Assane Mboup explique-t-il que « Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké a actualisé le concept de Khidma et son serviteur, Cheikh Ibra Fall, l’a matérialisé ». Il indique qu’il s’agit de repenser la place de l’humain à qui Le Tout-Puissant a accordé toutes les faveurs ; au-delà, il explique qu’il faut envisager le Khidma comme « l’homme obligé de servir car il n’est rien s’il est seul ; il n’est que parce que les autres sont », ce qui justifie, selon lui, chez les Soufis, la permanence du rappel de la place de l’humain.
On peut donc trouver des ponts très puissants entre notre islam confrérique et cette préoccupation chez Tariq Ramadan, bête noire des intellectuels islamophobes peuplant les plateaux de télé en Europe et aux Amériques, mais aussi des féministes depuis ses diverses condamnations pour viol en Europe. Ces dernières ont d’ailleurs manifesté quelques instants, samedi dernier, non loin des lieux de la conférence, avant d’être dispersées par les forces de l’ordre. Ne pas le souligner aurait ajouté à la clameur et fait dans la « désinformation » par omission. C’est que tous les ingrédients étaient réunis pour donner des couleurs et du bruit à son séjour : décrit comme « Frère musulman », l’organisation présente un peu partout dans le monde musulman, au pouvoir en Égypte avec Morsi le temps d’une… Salat, ce qu’il a toujours contesté ; petit-fils de Hassan El-Banna, le fondateur de la confrérie ; une des voix (controversées) de l’Islam dans les milieux universitaires en Occident ; mais surtout, brillant sujet et polémiste ancré… Mais que faisait donc Tariq Ramadan sous nos cieux en dehors de ses conversations intellectuelles ? En réalité, il est l’ami du guide religieux Serigne Babacar Mbow (décédé en 2024), devenu Talibé Baye-Fall ayant fait allégeance à Serigne Cheikh Dieumb Fall après des années de militantisme dans la Gauche, étudiant en France, parmi les rénovateurs du village de Mbacké Kajoor. En 1987, alors âgé de 25 ans, Tariq Ramadan avait effectué un séjour à Ndëm, le village fondé par Serigne Babacar Mbow. Dans un monde crispé par les radicalismes, les replis identitaires et les débats souvent hystérisés sur l’Islam, le Sénégal, avec sa tradition confrérique ancrée dans le soufisme, demeure un havre de dialogues féconds. samboudian.kamara@lesoleil.sn