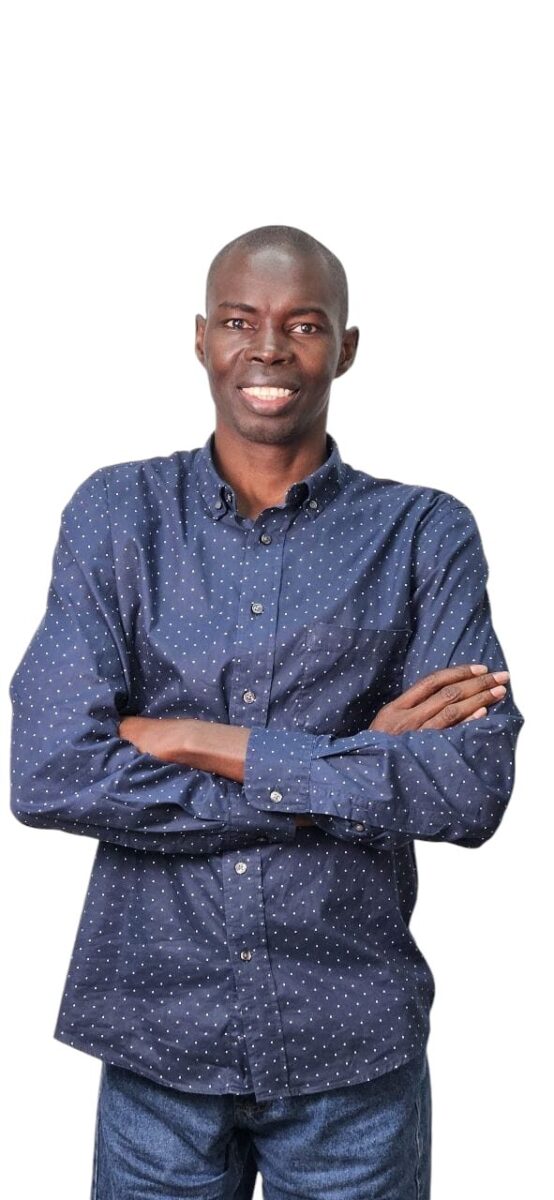« Le Sénégal est un pays énergétiquement béni… Mais les Sénégalais, sont-ils énergétiquement bénis ? »
L’eau et l’énergie sont les deux leviers les plus stratégiques pour la souveraineté et la stabilité de l’État. Elles conditionnent l’activité économique, la sécurité nationale et la qualité de vie des citoyens. Comme le rappelle Vaclav Smil dans Énergie et civilisation – Une histoire, « l’énergie est la seule monnaie universelle d’échange : toutes les actions humaines, du mouvement le plus simple à la transformation industrielle la plus complexe, exigent sa conversion ».
Dans ce contexte, le Plan de Redressement Économique et Social (PRES) représente bien plus qu’un simple programme de relance : il offre la marge politique et financière nécessaire pour repenser en profondeur un secteur électrique affaibli par des décennies de gestion fragmentée, de choix politiques à court terme et de dépendances structurelles. Avec la prolifération actuelle des agences et leur superposition, le PRES constitue une opportunité historique à ne pas manquer pour engager la restructuration, conquérir notre émancipation et assurer définitivement notre souveraineté énergétique.
Complexité et fragmentation institutionnelle
Le système électrique sénégalais souffre d’une complexité institutionnelle disproportionnée par rapport à sa taille. Quatre entités — trois agences et un régulateur — administrent un réseau de seulement 1,8 GW de puissance installée, pour un pays dont la consommation annuelle par habitant ne dépasse pas 370 kWh, l’une des plus faibles au monde, pour une population de 18 millions d´habitants. Cette architecture lourde serait déjà difficile à justifier dans un système de taille moyenne ; elle devient aberrante pour un réseau aussi limité, surtout au regard de nos ambitions affichées.
En effet, le Référentiel Sénégal 2050 fixe un objectif de 10 GW à long terme. Mais pour soutenir une industrialisation réelle, sécuriser l’approvisionnement et assurer notre souveraineté énergétique, nous devrions viser au moins 20 GW. Maintenir un tel niveau de complexité institutionnelle dans un système qui doit croître d’un facteur dix ou plus n’est pas seulement inefficace : c’est un frein structurel à notre développement.
À titre de comparaison, le Brésil, avec une population de 215 millions d´habitants, dispose de 225 GW de capacité installée et d’une consommation annuelle par habitant plus de dix fois supérieure, mais fonctionne avec une seule agence nationale forte, appuyée par un opérateur et un institut de planification. Cette prolifération institutionnelle au Sénégal dilue les responsabilités, ralentit la prise de décision et freine l’investissement productif.
À cette fragmentation s’ajoute le poids démesuré de la société nationale d’électricité, acteur unique et stratégique qui contrôle l’ensemble de la chaîne — de la production à la distribution. Loin de se limiter à un rôle technique, cette entreprise est depuis longtemps un levier de pouvoir, un centre de lobbies et un instrument de pression politique. Les choix d’investissement, les arbitrages tarifaires et même certaines interruptions ou priorités de desserte sont souvent influencés par des considérations partisanes, au détriment de la performance, de la transparence et de l’intérêt national.
Les pièges de Macky Sall
Lors de sa première rencontre avec la presse nationale en juillet 2024, le Président Bassirou Diomaye Faye a décrit, après son entretien avec l’ex-président Macky Sall durant la période de transition, un héritage énergétique alarmant : approvisionnement en hydrocarbures menacé, continuité du service électrique compromise, hausse imminente de la facture d’eau… et des navires à quai, attendant le paiement pour décharger. Tout semblait calibré pour recréer le climat explosif de 2011, lorsque le pays avait connu une crise énergétique majeure marquée par la pénurie de carburant, des coupures massives et une colère populaire sans précédent.
Le Président Diomaye a eu la lucidité d’alerter sur les « pièges » hérités de l’ère Macky, soigneusement installés pour peser sur l’action du nouveau gouvernement. Ce n’était que la partie visible d’un système de sabotage plus profond. Plutôt que d’engager les réformes structurelles indispensables, Macky Sall a instauré le système prépayé Woyofal, inspiré d’expériences en Afrique centrale. Présenté comme un outil d’économie pour les ménages, ce dispositif relevait en réalité d’un « self-islanding » (auto-îlotage volontaire) : le consommateur devient l’agent de sa propre coupure d’électricité. Dès qu’il n’a plus de crédits, il est automatiquement isolé du réseau. Officiellement, cela donne l’illusion d’une maîtrise personnelle de la consommation. En réalité, c’est une solution artificielle à un problème structurel : au lieu de garantir un approvisionnement continu et de traiter les causes profondes — production insuffisante, inefficacité du réseau, tarifs inadaptés —, on transfère la responsabilité sur l’usager. Ceux qui disposent de ressources financières restent connectés ; les autres s’auto-excluent, transformant la précarité énergétique en choix apparent.
Anticipant qu’il ne pourrait contenir durablement l’ascension du PASTEF, il a mis en place un schéma où son camp politique pouvait contrôler environ un tiers du système électrique, tout en compromettant la modularité du réseau. L’exemple de la centrale du Cap des Biches est particulièrement révélateur : avec ses 366 MW — soit près de 23 % de la puissance installée nationale — elle concentre une telle part de la production que toute panne majeure entraînerait un risque élevé de blackout national, faute d’unités de secours de même puissance capables de prendre le relais.
Plus insidieux encore, certaines de ces manœuvres relevaient de véritables sabotages techniques, dont les effets — volontairement différés — ne commenceraient à se manifester qu’entre deux et trois ans plus tard. Un délai suffisant pour donner l’illusion d’une stabilité, tout en préparant une instabilité énergétique programmée.
Un nouveau modèle énergétique sénégalais
Le PRES est l’occasion de remplacer ce patchwork institutionnel par une architecture claire et efficace, en mettant fin à la dispersion des responsabilités et à la duplication des missions. Aujourd’hui, plusieurs agences interviennent souvent sur les mêmes segments, avec des prérogatives qui se chevauchent, et certaines remplissent pratiquement les mêmes fonctions que la Senelec, créant un gaspillage de ressources et une dilution des responsabilités.
La réforme proposée repose sur deux piliers :
La création d’une Agence Nationale de l’Énergie unique, regroupant l’ensemble des fonctions aujourd’hui éparpillées : régulation, supervision de la production et de la distribution, suivi des indicateurs de qualité, exploitation du système, définition des spécifications techniques, fixation des conditions d’accès au réseau de base, organisation des appels d’offres, etc. Cette structure absorberait les missions actuellement dispersées entre organismes redondants, garantissant ainsi une gouvernance unifiée, une prise de décision plus rapide et une efficacité accrue dans la conduite de la politique énergétique nationale. Elle constituerait l’élément clé de la nouvelle gouvernance du secteur de l’électricité, capable d’accompagner l’industrialisation, de sécuriser l’approvisionnement et d’ancrer durablement la souveraineté énergétique du pays.
Un Institut de la Planification et de la Transition Énergétique, organe interministériel sous la tutelle du ministère de l’Energie incluant une participation active du monde académique, pour assurer un véritable pilotage stratégique. Ses missions incluraient la planification à long terme, la modernisation des réseaux (smart grids), la gestion de l’intégration des énergies renouvelables, le développement du marché du carbone et la préparation du pays aux transitions technologiques (stockage, hydrogène, efficacité énergétique).
Dans ce nouveau schéma, l’AEME verrait ses missions réorientées vers des programmes d’extension scolaires et universitaires solidement structurés, visant à sensibiliser à l’usage et à l’économie de l’énergie dès le plus jeune âge. Ces actions iraient de l’enseignement primaire jusqu’au soutien à des startups universitaires, et incluraient l’organisation annuelle des Olympiades nationales de l’efficacité énergétique, afin de stimuler l’innovation et l’engagement citoyen.
Une telle réforme mettrait fin à un problème séculaire de planification, réduirait les chevauchements institutionnels et permettrait de bâtir un mix énergétique cohérent, aligné sur nos objectifs d’industrialisation et de résilience climatique.
L’héritage de l’ère Macky Sall a laissé un secteur électrique exposé, vulnérable et insuffisamment préparé aux défis du XXIᵉ siècle. Le PRES peut être l’acte fondateur d’une véritable souveraineté énergétique, à condition d’assumer une refondation sans complaisance.
Le Sénégal est un pays énergétiquement béni, tant son potentiel couvre presque toutes les formes d’énergie — solaire, éolienne, hydraulique, biomasse, gaz et pétrole. L’enjeu, désormais, est de faire en sorte que chaque Sénégalais soit, lui aussi, énergétiquement béni, en ayant accès à une énergie fiable, abordable et durable, au service de l’industrialisation, du bien-être et de la souveraineté nationale.
Dr Mamour Sop Ndiaye
Mamour Sop Ndiaye est enseignant-chercheur et chef du Département de Génie Électrique au CEFET/RJ (Brésil). Spécialiste en Planification, Transition e Efficacité Énergétique. Vice-coordinateur du PASTEF Brésil, membre du MONCAP et du MONAPH. Fondateur de l’ONG Wells of Changes.