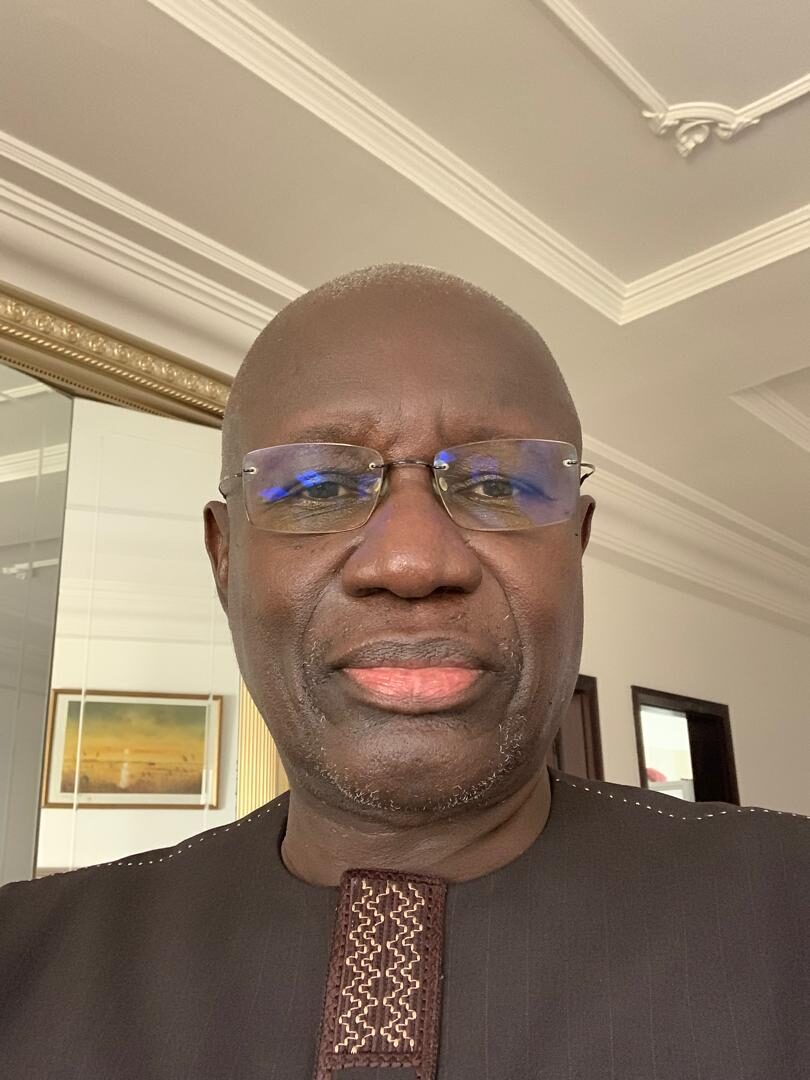La soutenabilité des finances publiques constitue l’un des fondements de la souveraineté étatique. Un Gouvernement privé de ressources financières stables perd sa capacité à conduire l’action publique et compromet la garantie des libertés collectives. Or, le Sénégal connaît, depuis plus d’une décennie, une aggravation de son endettement et une dérive des dépenses publiques. Cette situation pose avec acuité la question du redressement budgétaire, lequel ne peut être envisagé sans une maîtrise de la dépense.
Réduire la dépense publique apparaît dès lors comme un impératif de discipline financière et un acte de courage politique. Toutefois, une redynamisation du rôle du législatif s’impose afin d’éviter une gestion dominée par une logique de convenance politique plutôt que par les exigences de rigueur financière.
Mais l’effort de redressement ne saurait se limiter à une stratégie conjoncturelle de réduction des charges. Encore faut-il s’assurer que les dérives budgétaires constatées par la Cour des comptes dans son rapport d’audit sur la situation des finances publiques 2019-2024 ne puissent se reproduire, quel que soit le Gouvernement en place. C’est pourquoi l’analyse proposée ne vise pas seulement à rappeler les précédents historiques et à suggérer des instruments de maîtrise des dépenses, mais également à identifier les mécanismes institutionnels indispensables à la prévention durable de telles déviations.
Avant d’examiner les défis contemporains du redressement budgétaire, il importe de rappeler qu’ils ne sont pas inédits. L’histoire financière du Sénégal, dès les premières années de l’indépendance, a été marquée par des crises similaires qui ont conduit les autorités à adopter des mesures de rigueur exemplaires. L’exemple de l’année budgétaire 1963-1964 constitue à cet égard un précédent éclairant. L’analyse qui suit reviendra d’abord sur les enseignements de ce précédent, puis examinera la spirale de l’endettement récent, avant de proposer des réformes institutionnelles et budgétaires propres à garantir une discipline durable.
I. Les enseignements historiques de 1963 : un précédent en matière de rigueur budgétaire
Lors de l’examen de la loi de finances et d’habilitation pour 1963-1964, le ministre des Finances avait présenté devant l’Assemblée nationale un rapport fondateur, dessinant les grandes orientations financières à long terme.
Nous voici en « situation de combat sur le plan financier », disait-il, reprenant les propos du Président de la République du Sénégal dans son discours devant l’Assemblée nationale en 1963. En effet, l’année 1963-1964 demeure l’une des plus marquantes de l’histoire financière du Sénégal. La situation budgétaire nécessitait des mesures immédiates : certaines relevaient de la loi de finances 1963-1964, d’autres devaient avoir une portée plus structurelle. Ainsi, le budget de fonctionnement avait été voté en équilibre, totalement couvert par des recettes ordinaires, tandis que le budget d’équipement reposait sur ces mêmes recettes, complétées par l’aide financière de l’USAID et par divers emprunts.
Au cours des débats, le ministre des Finances rappelait les propos du chef de l’État devant les députés le 25 juin 1963 : « Il est dans notre intention de ne pas recourir pour le maximum prévu à l’emprunt mais de procéder, comme vous voulez bien nous y autoriser par l’article 16 de la loi de finances et d’habilitation, à des abattements tant sur les crédits de fonctionnement que sur les dépenses en capital. »
De plus, le Président de la République affirmait : « Chaque dépense en capital ne sera exécutée que si elle figure dans le Plan remanié et si les charges récurrentes qu’elle entraîne dans les années à venir peuvent être supportées par les prochains budgets. »
Dans ce contexte marqué par la fragilité budgétaire des premières années de l’indépendance, plusieurs axes furent mis en avant :
Maintien des mesures d’économie : prolonger les efforts d’assainissement budgétaire engagés en 1963-1964.
Priorité aux dépenses productives : donner la primauté aux investissements économiques sur les dépenses sociales, quitte à ralentir provisoirement la construction scolaire et hospitalière.
Limitation des dépenses de souveraineté : éviter l’augmentation des crédits militaires (hors génie) et diplomatiques, jugés non productifs.
Adaptation de la fonction publique aux capacités nationales : proscrire les revalorisations salariales jugées excessives, recruter par concours selon des plans à long terme et prévenir le clientélisme.
Autonomie financière des établissements publics et parapublics : réduire les subventions de l’État, renforcer le contrôle des dépenses par le corps des contrôleurs d’État.
Responsabilisation des collectivités locales : les communes devaient assumer leurs besoins financiers après une période d’appui de l’État.
Discipline de trésorerie : mettre fin aux avances systématiques des caisses de l’État et limiter strictement les avances pour l’équipement.
Ces orientations, formulées au début des années 1960, révèlent une conscience précoce des risques liés à l’expansion incontrôlée des charges publiques. Elles résonnent encore aujourd’hui : maîtrise de la masse salariale, réduction des dépenses de souveraineté, rationalisation des transferts et transparence des engagements financiers.
II. La spirale de l’endettement et l’érosion de la souveraineté budgétaire
Le recours systématique à l’emprunt au cours de la dernière décennie a permis de financer à la fois des infrastructures, des programmes sociaux et des projets de prestige. Toutefois, la stratégie dite du « roulement de la dette » — consistant à emprunter pour rembourser — a atteint ses limites. Les dettes cachées, mises en lumière par l’audit de la situation des finances 2019-2024, aggravent la fragilité de la situation budgétaire.
L’État doit désormais privilégier une logique de réformes internes : rationaliser les charges, renforcer les mécanismes de contrôle et limiter l’endettement futur.
Il convient de rappeler que la responsabilité de cette spirale de l’endettement ne saurait être imputée au seul pouvoir exécutif. Conformément aux dispositions de l’article 44 de l’actuelle loi organique relative aux lois de finances, c’est l’Assemblée nationale qui autorise chaque année, par le vote de la loi de finances, le niveau des dépenses et des recettes, arrête le solde budgétaire et approuve le tableau de financement. À travers ce vote, il confère au Gouvernement les autorisations de recourir à l’emprunt et de mobiliser les ressources nécessaires à l’exécution du budget.
Or, ce pouvoir d’autorisation n’est pas suffisamment accompagné d’un pouvoir de contrôle effectif. Le suivi parlementaire des déficits autorisés, de l’endettement et des conditions de financement reste largement théorique. En l’absence d’un contrôle rigoureux sur l’exécution des lois de finances, l’Assemblée nationale se trouve réduite à valider a posteriori des déséquilibres budgétaires dont elle a pourtant approuvé le principe. Cette carence affaiblit le rôle institutionnel du législatif comme gardien de l’orthodoxie budgétaire et contribue indirectement à la reproduction des déficits chroniques.
III. L’institution d’une Commission des économies
Il est proposé d’instituer une Commission des économies calquée sur le modèle de celle créée par le décret n° 63-228 du 11 avril 1963. Son rôle serait d’identifier les lignes budgétaires susceptibles de faire l’objet d’économies, en vue d’alléger la charge de l’État et d’optimiser l’utilisation des ressources.
IV. La maîtrise de la masse salariale : une priorité stratégique
La dépense salariale représente l’un des principaux postes budgétaires. Sa maîtrise ne suppose pas une baisse des salaires, mais un encadrement rigoureux des recrutements et des promotions.
1. La fixation, par la loi de finances, du plafond annuel d’emplois rémunérés par l’État (article 44 de la LOLF) constituerait un instrument complémentaire de régulation, garantissant une meilleure prévision des charges salariales et une transparence accrue dans la gestion des effectifs.
2. La Cellule de Contrôle des Effectifs et de la Masse salariale, jadis rattachée au ministère des Finances, devrait être réactivée.
3. Les recommandations du rapport 2018 de la Cour des comptes sur la masse salariale, qui avait relevé de graves insuffisances (procédures obsolètes, absence de contrôle interne, virements de crédits abusifs), doivent être mises en œuvre.
4. Les conclusions de l’audit du système de rémunération publique devraient également être exploitées.
5. La création d’un poste comptable principal du Trésor permettrait d’instaurer un véritable contrôle comptable. Ce poste aurait une double mission :
· le contrôle des rémunérations : vérification des éléments fixes de chaque nouvel agent recruté (traitement de base, grade, échelon) et des éléments variables mensuels (indemnités, primes, rappels, heures supplémentaires).
· le contrôle des pensions : suivi rigoureux des droits liquidés et du service des pensions, afin d’éviter les anomalies, doubles paiements ou charges indûment maintenues.
Une telle innovation introduirait une discipline financière indispensable, en réduisant les risques d’irrégularités et en garantissant la sincérité des charges de personnel.
V. La réforme du budget des charges non réparties et des dépenses de transferts
Deux postes budgétaires appellent une réforme structurelle :
· Le budget des charges non réparties (charges communes) : il est devenu un agrégat hétéroclite qui masque des dépenses peu transparentes. Une refonte devrait imposer une présentation détaillée des affectations et la suppression des lignes imprécises.
· Les dépenses de transfert : souvent instrumentalisées à des fins clientélistes, elles doivent être rationalisées selon des critères de performance et de justice sociale. La nomenclature budgétaire devrait être modernisée afin d’éliminer les lignes « Autres », sources d’opacité.
Mais au-delà des charges communes et des transferts, l’expérience historique de 1963 suggère qu’un instrument correctif plus direct pourrait être mobilisé : l’habilitation présidentielle à opérer des abattements.
VI. L’habilitation du Président de la République à opérer des abattements : enseignements de 1963
L’histoire financière sénégalaise fournit un précédent : l’article 16 de la loi de finances et d’habilitation du 28 juin 1963 avait autorisé le Président à opérer par décret des abattements sur les crédits budgétaires, après avis de la Commission des économies instituée par le décret du 11 avril 1963.
Il est suggéré de reprendre, dans la prochaine loi de finances, une disposition analogue :
« Le Président de la République est autorisé à opérer par décret des abattements sur les dotations applicables aux divers chapitres de crédits de fonctionnement et sur les dépenses en capital, après rapport de la Commission des économies… »
Une telle mesure permettrait de doter l’État d’un mécanisme correctif rapide, sans dépendre exclusivement de lois de finances rectificatives.
VII. Le contrôle des marchés conclus de gré à gré
Les grands marchés publics de l’ancien Gouvernement conclus de gré à gré, souvent justifiés abusivement par le « secret défense », doivent faire l’objet d’un contrôle spécifique. Un contrôle a posteriori systématique de ces marchés apparaît indispensable afin de vérifier la régularité des procédures, d’apprécier le rapport coût/qualité et de mettre en évidence d’éventuels surcoûts.
Un tel contrôle a posteriori renforcerait non seulement la transparence de la commande publique, mais aussi la discipline budgétaire globale, en réduisant les marges de surcoûts qui alimentent le déficit.
VIII. L’encadrement du pouvoir règlementaire budgétaire de l’Exécutif
Le pouvoir réglementaire en matière budgétaire considérable du Président de la République et du ministre des Finances appelle un encadrement juridique renforcé, fondé sur la transparence, la responsabilité et un contrôle accru de l’Assemblée nationale.
IX. Prévenir la récurrence des déviations budgétaires : garantir la soutenabilité institutionnelle du redressement
Comme annoncé dès l’introduction, l’enjeu central n’est pas seulement de réduire la dépense publique dans l’immédiat, mais de prévenir la reproduction des déviations structurelles qui minent la crédibilité de la gouvernance budgétaire.
Les constats de la Cour des comptes, dans son rapport d’audit 2019-2024 sur l’état des finances publiques, ont mis en lumière des déviations graves : création de comptes de dépôts au Trésor dont les opérations ne sont pas justifiées, ventes irrégulières de biens immobiliers de l’État, ouverture de comptes bancaires sans autorisation, dettes cachées, emprunts contractés sans aval parlementaire ou encore rachat de dettes privées en violation des règles organiques.
Pour que de telles pratiques ne se reproduisent plus, quel que soit le Gouvernement en place, il est nécessaire de renforcer le dispositif institutionnel de gouvernance financière. Trois leviers apparaissent indispensables :
· Le verrouillage juridique et normatif : les textes financiers doivent interdire expressément toute opération budgétaire hors loi de finances, assortir ces interdictions de sanctions et soumettre à l’autorisation législative préalable toute opération de dette ou de cession d’actifs publics.
· Le renforcement du contrôle parlementaire et juridictionnel : l’Assemblée nationale doit exercer un suivi effectif des autorisations de déficit et d’emprunts qu’elle vote, tandis que la Cour des comptes doit voir ses observations suivies d’effets contraignants dans des délais impartis.
· La transparence et la responsabilité : la numérisation des comptes de l’État, la publication régulière en ligne de la dette, le contrôle des opérations de trésorerie et des opérations patrimoniales, ainsi que la responsabilisation personnelle des ministres et ordonnateurs, constituent les garanties ultimes d’une discipline durable.
Ainsi, le redressement budgétaire ne peut être soutenable qu’à la condition d’un encadrement institutionnel permanent, capable de transcender les alternances politiques et de faire prévaloir la règle de droit sur la contingence gouvernementale.
Conclusion
Réduire la dépense publique est aujourd’hui un impératif vital. Mais cet effort n’a de sens que s’il s’accompagne d’un encadrement juridique strict, d’un contrôle parlementaire effectif et d’une responsabilisation accrue des gestionnaires publics.
Le véritable défi est de construire une gouvernance financière durable, capable de prévenir la récurrence des dérapages et de garantir que, quel que soit le Gouvernement, l’État demeure fidèle aux principes de transparence, de sincérité et de responsabilité.
Ainsi, la réduction de la dépense publique ne doit pas seulement être un exercice technique de rigueur, mais un acte de souveraineté et une exigence de responsabilité publique : faire prévaloir la discipline financière sur les aléas de la conjoncture politique.
Par Mamadou Abdoulaye SOW
Inspecteur principal du Trésor à la retraite